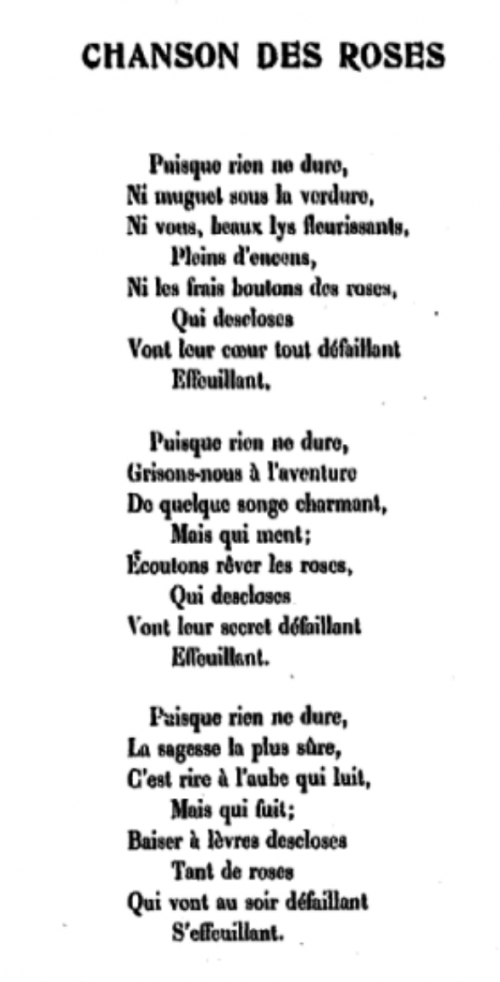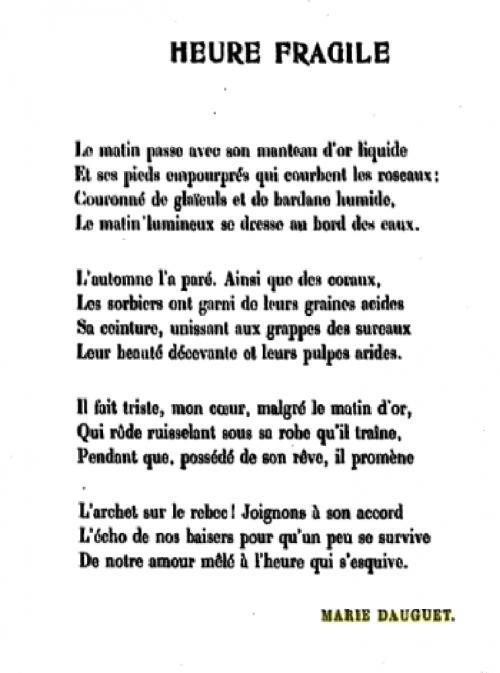Dauguet (Marie) 1860-1942
La gerbe
Je ressemble au bouleau humide sous la pluie,
Au frêne désséché que drape au bord de l'eau
Le salissant brouillard de ses voiles de suie;
Mon âme a la couleur d'un vieux tombeau.
Je suis le naufragé cramponné au radeau
Que la vague, linceul, de ses longs voiles essuie;
Mon coeur que le labeur trop lourd de vivre ennuie,
Comme un galérien courbé sous un fardeau,
Succombe et se révolte en la fadeur des choses.
Et me voici, fantôme assis sur un tombeau,
Groupant entre mes doigts, dernier bouquet de roses,
La gerbe de mes désirs morts. - O noirs corbeaux,
Parmi le ciel flétri promenant vos ténèbres,
Autour de ma pensée, errez, troupes funèbres!
Aurore
Dans l'étable nuiteuse encor les bœufs s'ébrouent.
Etirent lourdement leurs membres engourdis,
Réveillés tout à coup par un coq qui s'enroue
Et dont le cri strident semble un poignard brandi.
Trempé d'aube, dehors, le fumier resplendit
Contre un mur délabré qu'une lucarne troue,
Parmi des bois pourris, des socs, des vieilles roues,
Et lance vers le ciel des parfums attiédis.
Cernant une écurie ouverte au toit de mousse.
Qu'emplit un vibrement nuageux d'ombre rousse,
Du purin, noir brocard, s'étale lamé d'or,
Où fouillent du groin activement les porcs,
Et dans la paille humide et qu'ils ont labourée
Le soleil largement vautre sa chair pourprée.
Par l'Amour
La folie des parfums
Que je les goûte et que j'en meure,
Tel un philtre aphrodisiaque,
Les parfums déments qui m'effleurent
Embrumant les nuiteux cloaques.
Que j'en comprenne le mystère
De cet étourdissant breuvage,
Effluve de Pan solitaire
Dansant par les tourbeux pacages.
O voluptés exténuantes,
Odeurs, qui sont des mains tenaces,
Des souches que l'hiver crevasse
Des champignons aux chairs gluantes.
Comme un Dieu qui m'enlacerait,
Que votre errance me possède,
Plus mythique qu'un chant d'aède
M'enseignant le divin secret.
Le reïtre
Je rêve parfois d'une existence brutale;
Le donjon sur un roc inaccessible, au loin
L'humanité courbée et vague, et surtout point
De frein. Comme un fleuve ma volonté s'étale.
Je ne suis vraiment sous la couronne comtale
Qu'un reître violent, dépourvu de tous soins
Autre que le pillage et l'orgie, et j'ai moins
D'âme que mon épervier. Nulle décrétale
Ne contraignit jamais mon désir et je vais
Triomphant, au trot lourd de mon cheval de guerre
Ecrasant sans le voir tout ce qui grouille à terre:
Prêtres, soudards, vilains. Je vais le coeur en paix
Et trempant pour le teindre aux couleurs de ma gloire,
Parmi le sang versé mon étendard de moire.
Les purins noirs
Je suis l'aire sonore aux rythmes des fléaux,
Quand les récoltes en hiver sont engrangées
Et que le grain luisant s'entasse par monceaux
A l'entour des hautes gerbes érigées.
Je suis ces mots très beaux et que l'on chante aux bœufs
Alors que la tiédeur du printemps apparue,
On s'en va retourner le chaume encor fumeux,
Les deux poings appuyés aux mains de la charrue.
Et je suis à travers le gazon rajeuni
Les bonds du poulain vif et que l'on désentrave.
Des brebis nous suivant quand on leur dit: « Véni »,
Et le heurt des sabots de la chèvre au flanc cave.
Je suis en juin, le fredon sur les mélilots
De l'abeille enivrée, en la saison charmante
Des cerises, je suis le fifre des loriots ;
Le crisselis des foins que la brise tourmente.
Je suis cet hymne d'or des blés tout crépitants,
Le cri doux des bleuets en foule,
Et ce soupir profond, cet appel haletant
Qui monte de la glèbe où le soleil s'écroule.
Je suis la vigne avec ses résonnants coteaux
Et ses roux néfliers où s'abattent les grives ;
Le chœur des vendangeurs près des rouges cuveaux
Et leur rire que l'air bleu du soir enjolive.
Je suis, dans le jour gris qui mouille les troupeaux,
Le rythme délassant des cloches à la tierce,
Et, se mêlant au vent, dont tremblent les pipeaux,
Par les pâquis, les clapotis lents de l'averse.
Quand les celliers sont pleins de choux et de navets.
Je suis le clanchement de l'huis que l'on referme;
Je suis les longs récits, les bourdonnants rouets
Dans la cuisine heureuse et calme de la ferme.
Triomphants, familiers, sublimes, tous les sons
Que rend l'âme vibrante et forte de la terre.
Résonnant dans mon âme au même diapason :
Je suis l'âme vibrante et forte de la terre.
Les Pastorales.
Le sainfouin
J'irai avec mon rêve au creux des sainfoins doux
Et la terre me bercera sur ses genoux.
Un lent balancement d' arc-en-ciel en folie.
Tout un prisme fluant dans la brise amollie.
Tremblera sous mes cils. De languides sanglots
Sortiront des épis roses, heurtant leurs flots.
J" aurai l'oreille auprès du cœur fort de la terre
Et je l'entendrai battre à grands coups ; la lumière
S étendra sur mon corps et j'ouvrirai les bras;
Tout le ciel, se courbant vers moi, me baisera.
Je ne saurai plus rien de ma vie trop étroite
Et me disperserai aux phrases qui miroitent,
Comme un ruisseau flexible au soleil, des loriots
Venus pour picorer les juteux bigarreaux.
En une averse d'or aux ronflantes rafales,
Autour de moi pleuvront les cris drus des cigales.
Parfois, j'écouterai, quand se tait leur concert,
Que l'espace devient comme un temple désert,
Après un grand silence, où tout semble l'attendre,
Le vent, aux pas rythmés, de l'empyrée descendre;
Poursuivre par les champs lumineux, noblement,
Excitant des épis la pourpre turbulence.
Sa danse fastueuse à la juste cadence.
Alors te saisirais- je au tourbillonnement
Des forces déchaînées; en cette griserie
De la terre amoureuse et qui soudain s'écrie
Et se tord de plaisir, innommable idéal.
Toi que j'ai tant guetté en son souffle augurai?
Volupté sans pareille, à mon désir mystique
Inguérissablement, quand te livreras-tu?
Mon cœur est dénué, avide, dévêtu.
Quand l' ébranleras-tu d'un spasme magnifique?
Idéal inconnu ton parfum tremble-t-il,
Comme une odeur charnelle attachée à nos paumes,
Dans ma main tâtonnant la terre et ses arômes,
Entre mes doigts rejoints sur l'odeur des pistils?
Vraiment quand le ciel penche au niveau de ma bouche,
Ai-je de ton baiser goûté l'ardeur farouche?
M'appartiens-tu? Oh ! oui, je te crée par mes vœux;
Toi que j'ai rêvé, existe ! Je le veux !
Les Pastorales.
Sotto voce
Il est doux de mourir un peu
Aux berges des forêts mouillées,
Et parmi les feuilles rouillées
Qui s'égouttent du brouillard bleu;
Il est doux de mourir un peu.
Il est doux de n'être plus rien
Que la brume qui s'échevèle,
Moins que le frôlis sourd d'une aile,
Aux velours pourpré des fusains;
Il est doux de n'être plus rien.
Il est doux de mourir un peu
Avec les eaux qui se corrompent,
Avec les lointains qui s'estompent,
Avec les buis, les houx fangeux;
Il est doux de mourir un peu.
Il est doux de n'être pus rien,
Moins que le frisson d'une rose,
Dont le vent d'hiver décompose
La chair de nacre et de carmin.
Il est doux de n'être plus rien.
A travers le voile, 1902
Ode à l'amant
Tu es la vigueur du soleil
Et ta sève embaume.
Elle est un ruisseau de mai sous l'aubépine,
Plus douce que la fleur du sureau.
Tu te dresses et tu es la force de la forêt!
Tes reins blessent mes mains nouées,
Tu es rude comme un chêne.
Je t'ai baisé comme un rouge-gorge dans ma main,
J'aime la tiédeur de ton corps dans ma main.
Je me rassasie de ton odeur sauvage;
Tu sens les bois et les marécages
Tu es beau comme un loup,
Tu jaillis comme un hêtre
Dont l'énergie gonfle l'écorce.
... Le nœud de tes épaules est dur sous les mains;
L'axe du monde est dans ta chair.
... Mais je louerai ton cri sauvage,
Mais je louerai ton corps qui embaume,
C'est un bois sauvage aux rudes fleurs.
Je louerai ta brutalité,
Le sanglot rauque de ta chair;
Je louerai ta sève immense
Où l'univers est en puissance.
Je louerai tes poings et comment ils se dénouent
Tout à coup quand tu retombes
Au creux d'une épaule,
Plus doux qu'un petit enfant
Et plus innocent qu'un ange.
(Extrait de Ce n'est rien, c'est la vie - Ed. Chiberre, 1926)
Alors que nous nous effaçons
Alors que nous nous effaçons,
Ainsi qu'au penchant des saisons
L'or des éphémères moissons;
Que sous les paupières qui saignent
Et dans les larmes qui les baignent
Tant de regards blessés s'éteignent;
Que, du soleil abandonnés,
Cendreux bleuets embruinés,
Tant d'yeux humains se sont fanés;
Que pareilles aux flots qui roulent,
Leur cours aux grèves qui s'écroulent,
Les générations s'écoulent,
Et qu'à l'abîme qu'il pressent
Chaque homme va disparaissant,
Tel un naufragé pâlissant,
Pendant qu'aux pentes des vallées
Filtrent, des tombes descellées,
Et du marbre des mausolées,
Et des sépulcres crevassés
Sous les vieux ormes délaissés,
Tourbillons par le vent poussés,
Tant d'ombres et de cendre vaine,
O Nature calme et sereine,
Tu te dresses comme une reine,
Et debout à travers le temps,
Toujours jeune et sans changement,
Subsistant invinciblement,
Tu souris, entre tes mains pures
Tenant, aux riches ciselures,
La clef d'or des aubes futures,
Et moi qui fuis comme le vent,
- Vers quel horizon décevant? -
Atome d'infini rêvant;
Emporté par quel noir quadrige
Que l'heure hâtivement fustige,
Il me reste, dans ce vertige,
Et du néant sombre guetté,
Ce bonheur d'avoir reflété,
Nature, et compris ta Beauté,
Cet espoir profond de renaître
Aux bourgeons emmiellés des hêtres,
Aux chansons des huppes champêtres,
Au cours des ruisseaux opalins,
Aux frissons bleuissants des lins,
Au rire emperlé des matins!...
18 février 1904
(Extrait de Ce n'est rien, c'est la vie - Ed. Chiberre, 1926)
Cantiques à la lune
Lune qui t'endors à côté des charrues,
Attirant jusqu'à toi, comme d'un sein ouvert,
Les parfums du sillon et des sauges bourrues
Que le soc a fendus aux premiers jours d'hiver.
Tu veilles les troupeaux, broutant près des tourbières
Le thym et les orchis aux grappes de rubis,
Et tu tais tressaillir vers ta molle lumière
Les agneaux enfermés au ventre des brebis.
Lune printanière et maîtresse des germes.
Tu exaltes l'odeur des mares croupissant'
Au long des murs d'étable et des portes des fermes
Qu'estompe à ta lueur un ténébreux encens.
Tu fais goûter l'odeur, douce comme une amie,
Qui traverse les toits abritant le bétail.
Celle des bœufs repus, des vaches endormies.
De la paille froissée où plonge leur poitrail.
Tu provoques la forte et sereine ambiance
Qui suinte des blés roux tassés sur les greniers
Et cette odeur de paix, qui donne confiance,
Des meules de fourrage et des tas de fumiers.
Lune printanière et telle une déesse
Qui pose sur les joncs l'éclat de tes pieds blancs
Et sème la moelleuse et flottante caresse
De tes cheveux au ras des moires de l'étang.
Lune, tu fais chanter sous l'oseille sauvage
Que frôle ton orteil d'ivoire, les crapauds.
Et pleuvoir la rosée au bleuissant treillage
Des saules prosternés et des tièdes sureaux.
Zébrant de tes lueurs l'ombre chèvrefeuillée.
En ton mauve péplos tu t'assieds sous les troncs
Et parmi l'herbe humide et les sauges mouillés.
Tu penches ton visage et tu baignes ton front.
Lune, voici mon cœur, brin séché de fougère,
Perdu dans l'épaisseur des bois enténébrés,
Lune, voici mon cœur, sombre rameau de lierre
Au pan de ce mur noir durement enserré.
Eclaire-le, ce cœur, mendiant misérable
Et qu'à l'immense fête on n'a point convié.
Triste quand sont joyeux l'églantier et l'érable,
Mon cœur humain qui pense au lieu de verdoyer.
Que ton rayonnement l'apaise et le pénètre.
Ce cœur comblé de nuit, d'un dieu déshérité.
Lune, verse sur lui comme aux branches des hêtres.
Ton calme enchantement et ta sérénité.
(Par l' Amour.)
(Je vivrai dans l'odeur des glèbes embuées)
Je vivrai dans l'odeur des glèbes embuées,
Quand on attache, en mars, les bouvaçons au joug
Et qu'ils s'en vont traînant, sous la rose nuée,
La charrue ou la herse aux cahotants écrous.
Je vivrai dans l'odeur du marécage roux,
Lorsque au nerveux soleil, qui sous l'eau les chatouille.
Entre les iris blonds, les carpes dorées grouillent ,
Et fraient, collant au sol vaseux leur ventre doux.
Quand la sève en vertige, avec des frissons blêmes.
Met au cœur de la planta un sensuel émoi
Et fait jaillir la fleur du bourgeon trop étroit,
Je vivrai dans l'odeur du grand spasme suprême.
Je vivrai dans l'ardeur des succulents épis,
Que nourrit la clarté vivante du soleil ;
Dans l'odeur des troupeaux, par les sombres vermeils
Broutant, et des ruchers sous leurs vieax toits tapis.
Je vivrai dans l'odeur des couchants évirés
Sur les marais plaintifs où s'efïeuille l'automne
Et dans celle du vent, monotone cromorne,
En hiver poursuivant ses refrains altérés.
Je vivrai dans l'odeur des succulents épis,
Depuis l'avril dansant sa danse orgiastique,
Jusqu'à décembre noir au sommeil léthargique,
Dans l'odeur de la brise et celle des antans.
Pour l'avoir déchiffrée, l'énigme au sens profond.
Et fièrement chantée, mieux que nul autre sur
La musette rustique et le flageolet pur,
Je vivrai dans l'odeur divine des saisons.
(Les Pastorales.)
(Ma flûte)
Ma flûte rauque n'est pas faite de roseaux
Cueillis au pied du Ménal ou de l'Erymanthe,
Elle est fruste et taillée aux branches des sureaux,
Moite de sève encore, âprement dissonante.
Ma flûte rauque n'est pas faite de roseaux
Coupés classiquement où du soleil soupire,
Alignant leurs tuyaux rejoints et inégaux,
Sous l'écheveau de lin et que colle la cire.
Elle est de bois dur, dissonante dans le vent,
Et sussure en mineur, pleine de sourds bécarres
Ou d'étranges bémols qui vont se dissolvant
Avec le cri bleu des crapauds au bord des mares.
Dans La Plume, 1889
(Margot, Margot)
Margot, Margot, viens respirer l'arôme
Des lys blancs où la lune a neigé.
- Je dois faire la soupe pour mon homme,
J'arrache des navets au potager.
Margot, Margot, vois la folle mésange
Tresser son nid aux branches des rosiers.
- Je dois, je dois, pour que la vache mange,
Porter de l'herbe fraîche au ratelier.
Margot, Margot, sur leur aile de soie,
Viens caresser ces ramiers amoureux.
- Il faut, il faut que je garde mes oies
Et mes canards auprès du ru fangeux.
Margot, Margot, tout le ciel en tressaille,
Le rossignol commence à gazouiller.
- J'aime bien mieux écouter mes volailles
S'égosiller au fond du poulailler.
Dans La Plume, 1889.
(La maison de granit)
La maison de granit qui luit comme du sel,
Rêve, les volets clos, sous un lourd toit de chaume;
Rien qu'un branle de rouet dans la cuisine, auquel
Font écho les fredons du rucher. .. - Tout embaume,
Le jasmin de la porte et les fruits du verger,
Les roses s'effeuillant parmi l'herbe fauchée,
Les brugnons mûrissant au long des espaliers
Et, dans un coin, la menthe et l'anis par torchées.
Tout embaume en silence, et les touffes de buis,
Et les oeillets là-haut garnissant la la faitière,
Et l'eau sombre qui dort au gouffre vert du puits,
Où tremble un peu d'argent entre deux brins de lierre.
Dans La Plume, 1889.
Les croix
Les croix, les croix, les croix, toutes les croix des chemins,
Au pied desquelles les mendiants mangent leur pain,
Les croix, les croix, toutes les croix des chemins.
Les croix, les croix solitaires près des mares
Et dans l'odeur de la mousse qui les bigarre,
Les croix, les croix solitaires près des mares.
Les croix qu'on élève en l'honneur des noyés,
Que le remous louche et sournois vient épier,
Les croix qu'on élève en l'honneur des noyés.
Les croix tout de travers au coin d'une lande,
Où pendent des ex-voto et des guirlandes,
Les croix tout de travers au coin d'une lande.
Et les croix qu'on rencontre aux endroits perdus,
Près des étangs déserts et des chênes tordus,
Et les croix qu'on rencontre aux endroits perdus.
Les croix qu'on suspend, qu'on grave ou qu'on applique
Aux troncs des hêtres, dans les bois mélancoliques,
Les croix qu'on suspend, qu'on grave ou qu'on applique.
Les croix qui dorment à travers le passé,
Comme la croix de la forêt de Vélorcey,
Les croix qui dorment à travers le passé.
Les croix de bois sur lesquelles on peut lire:
"Seigneur, ayez pitié d'une pauvre martyre!"
Les tristes croix vers qui la douleur soupire.
Dans La Plume, 1903, p. 32-33..)
- La Naissance du poète, 1897.
- A Travers le Voile, Vanier, Paris, 1902,
- Les paroles du Vent, 1904
- Par l'Amour (couronné par l'Académie française). Société du « Mercure de
France», Paris, 1906, in-18.
- Clartés, Sansot, Paris, 1907, in-18.
- Les Pastorales, Sansot, Paris, 1908. in-18.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 176 autres membres