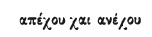Delarue-Mardrus - Occident (1901)
Delarue-Mardrus
Occident (1901)
CETTE AME QUI DANS LA VIRGINITÉ D'HIER AINSI PARLA ET CHANTA LOIN DES PAROLES ET DES CHANTS HUMAINS, JE LA DÉDIE TOUTE AVEC SES POÈMES - DIVERSIFIÉS SELON UNE LENTE INSPIRATION D'ÉCLECTIQUE FORME SPONTANÉE - A CELUI-LÀ QUI POUR LE FUTUR L'A SITUÉE DANS LA VIE,
LE DOCTEUR J. C. MARDRUS
MON MARI.
L. D.-M.
En plein vent
Bonne nature, as-tu des baisers pour les lèvres ?
Des épaules pour les fronts lourds ?
Des fleurs pour la beauté ? des fraîcheurs pour les fièvres ?
Et, pour les membres restés gourds
De sortir de l'hiver aux froides fantaisies,
Ton printemps répand-il d'étirantes tiédeurs ?
As-tu des coins cachés pour les chagrins en pleurs ?
La narine béante avide d'ambroisies
Fleurera-t-elle en toi sa satisfaction ?
As-tu pour le rire et la joie
Des pourpres dont l'ampleur magnifique s'éploie,
Et des deuils pour l'affliction ?
Ces baisers, ces tiédeurs, ces fraîcheurs, ces corolles,
Ces recoins secrets pleins d'accueil,
Ces parfums aussi doux que de bonnes paroles
Et cette pourpre et ce grand deuil,
Si vraiment tu les as, Nature, ô maternelle,
Si ce n'est pas un songe, à moi donc tous ces biens !
Le printemps tout entier gonfle mon coeur; je viens
A ta coupe qu'emplit la jeunesse éternelle,
Et j'y veux étancher la soif que je ressens,
Et j'y veux, oubliant mes peines,
Sentir le renouveau m'envahir jusqu'aux veines
De grands espoirs adolescents.
Enveloppe ma joie avec de belles robes
Que sur moi développeront
Le rouge des couchants et le clair bleu des aubes;
Voile ma douleur, si mon front
Persiste à conserver ses tristesses inertes,
Dans les grands crêpes noirs de tes nuits sans clartés.
Ah ! je m'enivrerai parmi les ombres vertes
Des grands arbres qui font, ainsi que des doigts gais,
Choir leur floraison sur les faces,
Et, comme des amis, je presserai leurs masses
Entre mes deux bras fatigués !
Laisse-moi me coucher ainsi que joue à joue,
Calme comme à l'heure où l'on dort,
Dans l'herbe où des blancheurs d'ombelles font la roue,
Lourdes du poids d'un bourdon d'or;
Laisse-moi respirer ton haleine champêtre
Où passe la douceur de quelque souffle humain;
Laisse-moi me pencher, un bouquet à la main,
Sur tes étangs profonds où je ris d'apparaître,
Pour boire à plein gosier leur liquide cristal,
Tendre à tes sources mes deux paumes,
Ecouter tous tes chants, goûter tous les arômes,
O Sève ! ô Printemps triomphal !
Je veux aller là-bas, je veux aller très loin,
Dans la campagne où l'air garde le goût du foin,
A travers les grands prés où sont les marguerites
Qui balancent au vent le sommeil des bourdons,
Où sont les vols, les cris, où sont tous les fredons
Et les grillons discrets crissant leurs menus rites...
Je veux aller là-bas, je veux aller très loin,
Dans la campagne où l'air garde le goût du foin.
Je veux aller là-bas où sont les chansons bleues
Que la mer à la grève apporte de cent lieues,
Au bord du flot tranquille où l'on puise en chemin,
Parmi les cailloux durs et les roches cabrées
Que monte chaque soir la fureur des marées,
Un peu d'immensité dans le creux de la main...
Je veux aller là-bas où sont les chansons bleues
Que la mer à la grève apporte de cent lieues.
Je veux aller là-bas sous les arbres géants
Où semble haleter la voix des océans
Et qui laissent tomber sur le sourd de la mousse
Comme des gouttes d'eau leurs pétales muets,
tandis que leurs oiseaux ont des hymnes fluets
En l'honneur du ciel pur et de la brise douce...
Je veux aller là-bas sous les arbres géants
Où semble haleter la voix des océans.
Je veux aller partout où vont les folles courses,
Cueillir toutes le fleurs et rire dans les sources,
Suivre tous les sentiers, chanter tous les refrains,
Et pour te réciter ma laude quotidienne,
Et pour t'adorer toute, ô nature païenne,
Seule, le coeur en joie et les cheveux aux reins,
Je veux aller partout où vont les folles courses,
Cueillir toutes les fleurs et rire dans les sources !
Parmi la pureté du matin triomphant,
Je vais, le souvenir encor si frais dans l'âme
Du temps où je n'étais qu'un embryon de femme,
Qu'il me semble donner la main à quelque enfant.
L'herbe est froide à mes pieds comme de l'eau qui coule,
La mer au bout des prés vient chanter son bruit clair
Et la falaise aussi déferle dans la mer
De tout le terrain jaune et mou qui s'en éboule.
Les troupeaux comme au long d'un poème latin
Paissent avec des ronds de soleil sur leurs croupes,
Et les oiseaux de mer ont abattu des groupes
Que chaque vague berce à son rythme incertain.
Et la prée et les eaux également étales
Sourient si bien à mes matineux errements
Qu je voudrais pouvoir entre mes bras normands
Prendre en pleurant ma mer et ma terre natale,
Tout ce coin de nature en qui j'épancherais,
Comme en l'asile offert de quelque sein de femme,
Câlinement, les yeux fermés, toute mon âme
Si lourde de tristesse et de mauvais secrets.
Rôde à pas lents au parc mystérieux
Où tes deux yeux profonds s'étaient remplis d'automne,
Et où à présent tu t'étonnes
De ne plus piétiner ton rêve soucieux
Parmi le foisonnement jaune des feuilles mortes,
Et de voir que partout triomphe l'été vert.
Puis tu t'en iras par les grands prés vers la mer;
Puis tu t'en reviendras par la petite porte
Hanter les potagers lourds de légumes gras,
Gais de leur symétrie étroite et maraîchère,
Et le mignard jardin aux flores d'apparat
Aussi riches que des joyaux,
Strictement répété à rebours dans les eaux
De l'étang clair où choit la source:
Afin qu'en ta première course
Tu puisses sourire à tous ces coins qui l'accueillent,
Qui te saluent avec leurs feuilles,
Avec leurs fleurs des champs, avec leurs fleurs de serre,
Avec les vagues de la mer,
Avec les buis naïfs et crus des potagers, -
Pour, après, revenir à la maison âgée
Qui est un peu une grand'mère
Et où tu sentiras tant d'intime douceur
Que tu croiras tout bas avec des larmes claires
Que quelqu'un au retour te presse sur son coeur.
Sous le frôlement doux des iris violets,
Le chaume rit, peuplé par les gais triolets
Des pigeons amoureux abattus dans sa paille.
Voici venir l'instant de la grande ripaille,
Et tous les animaux, au soleil, attroupés,
Attendent à la place ordinaire, campés
Qui sur le fumier, qui sous la porte normande,
En foule bigarrée, inquiète et gourmande.
Et lorsque la fermière arrive, relevant
Son tablier rempli de grain, la coiffe au vent,
Tous l'entourent, criant, volant, remplis de haine
L'un pour l'autre; et bientôt les gros pourceaux sans gène
Bousculent du grouin la volaille, éveillant
Un émoi d'un instant dans le fouillis grouillant.
Mais vite l'on revient au grain. Inassouvie,
Chaque bête soutient sa lutte pour la vie,
Et tant pis pour le faible: on lui marche dessus !
Les gros dindons ventrus, imposants et cossus,
Les pigeons blancs du toit, les oiseaux du ciel même,
La troupe accourt, s'empresse, approche, se parsème
Et, de l'endroit où gît l'amas des grains dorés,
On n'aperçoit plus rien que des dos affairés.
Les voraces canards, d'allure disloquée,
Fouillent le tas épais d'une brusque becquée,
Et, tout en s'étouffant la panse, par surcroît
Allongent de grands coups aux poules. Comme un roi,
La crête reluisante et la queue en panache,
Le coq, dressant sa tête avec un air bravache,
Répond par un appel roulant et guttural
Si, dans le bruit que fait cet émoi général,
Il reconnaît le cri d'une poule offusquée.
Et pendant que, pillant la pitance attaquée,
Les bêtes au soleil achèvent leur repas,
La fermière, proprette et ronde, à petits pas
S'en retourne à travers la rustique avenue,
Calme et sans se presser, comme elle était venue.
J'arpente bien souvent l'honnête basse-cour
Pour en rire à part moi. Comme des gens de Cour,
Les poules, au soleil, s'en vont en caravane.
Parmi les boutons d'or chacune se pavane,
Jacasse, met son mot au bruyant hourvari,
Et, soulevant le chef d'un geste renchéri,
Guette d'un oeil tout rond, ^rête à prendre l'alarme,
Le gros coq qui s'avance à grands pas de gendarme.
Lui, secouant au vent ses plumes camaïeu,
En maître de sérail se plante au beau milieu,
Courtise tour à tour chaque dame touffue
Et, frappant le sol dur de sa patte griffue,
Lance le fier appel de son cokeriko.
A son côté, lissant sa robe rococo,
La favorite cherche une graine oubliée;
Baissant piteusement sa tête humiliée,
Un poulet, qu'un essai trouva trop jeune encor,
Admire le pacha qu'il fixe d'un oeil d'or
Et cherche quel moyen la nature vous prête
Pour se faire pousser très vivement la crête.
Une mère, affairée à ce rôle tout neuf,
Suit ses poussins encor ronds du moule de l'oeuf,
Tandis qu'avec cent tours, cent courses insensées,
Cou tordu, bec ouvert, deux poules hérissées
Cherchent à se reprendre une croûte de pain
Qu'une d'elles vola dans la niche au lapin.
Et le soleil, luisant sur tout ce petit monde,
Gambade par les prés, s'étale comme une onde,
Et, tout en entraînant après soi l'univers,
Garde de chauds rayons aux moindres recoins verts.
Le vent chante à mi-voix des chansons bucoliques
Dans les roseaux mélancoliques.
Les roseaux au passage ont pris sa grande voix,
Un par un et tous à la fois.
Et l'un succède à l'un qui tremblote et déclame
Et tient sa place dans la gamme.
Goutte de bruit, son pur, son frais, chaque roseau
Imite une gorge d'oiseau ;
Mais au loin fait l'envol de leurs notes furtives
Un choeur de flûtes primitives.
Chantez l'heure qui passe, aube, vesprée et nuit,
Bleu frôlement de l'aube au bord du lointain sombre,
La vesprée au ciel pur, taches d'or, taches d'ombre,
Et la paix des couchants où la pourpre reluit ;
Chantez l'idylle assis ou bien agenouillée
Qui sourit, couple heureux du geste qui le tient,
Et les bouquets cueillis et le baiser païen
Simple, pudique et clos comme une fleur mouillée ;
Chantez la pastorale agreste, les troupeaux
Assoupis parmi l'herbe où crissent les cigales,
Les bergers, célébrant de leurs flûtes égales,
Deux à deux, trois à trois, la torpeur du repos ;
Chantez les vieillards lents assis au seuil des portes,
L'enfance et la jeunesse et le rire et les pleurs;
Chantez les cheveux blonds et noirs où sont les fleurs,
Chantez les cheveux blancs coiffés de feuilles mortes.
Un par un et tous à la fois,
Frôlement sous le vent au loin, mi-bruit, mi-voix,
Roseaux dont fait l'envol de vos notes furtives
Un choeur de flûtes primitives...
Des taches de couchant tombent à travers bois
Comme des larmes d'or sur les troncs; et les voix
D'eau claire des oiseaux se taisent goutte à goutte,
Cependant qu'un entend s'éloigner sur la route
Un dernier pas humain, un dernier bruit d'essieux
Et que, traînant encor des cloches dans les cieux
Comme des oraisons lointaines et des plaintes,
L'existence s'endort au fond des demi-teintes...
O ! la dévotion profonde, la grandeur
Du rêve qui nous monte alors du fond du coeur,
Comme si notre soif allait boire le monde,
Ou comme si, perdant pendant une seconde
Conscience du temps, de l'espace, du lieu,
Notre raison humaine allait comprendre Dieu !
Il faut, dans la tiédeur estivale des jours,
Aimer le blé nouveau sorti des bons labours
Dont les épis égaux penchent leurs têtes mûres.
Houle ou repos; silence ou concert des murmures;
Marée où disparaît la motte et le lopin,
Autour de qui le vent fleure déjà le pain
De par la floraison en masse des fécules,
Sous les ciels envahis du sang des crépuscules,
Des gris troubles de l'aube ou du bleu des midis;
Puis aimer l'homme, alors prêtre auguste, tandis
Qu'il courbe jusqu'au sol son échine asservie
Et mêle sa besogne au grand oeuvre de vie
Dans l'étreinte du geste intime qui l'unit
A pleins bras, à pleins corps, à ce froment béni,
A cette toison d'or dont frissonne la plaine
D'où naît, pour assouvir l'immense faim humaine,
Refaire chastement et saintement la chair,
Le pain quotidien qu'enseigna la Pater !
Belle, voici venir les heures lentes, lentes...
Pose ton front rêveur au glauque des carreaux
Et dilate bien tes prunelles vigilantes.
Que tes yeux voient roussir dans les sentiers ruraux
La branche folle qui, triste que l'été meure,
Balance au vent un vol posé de passeraux.
Voici le temps où l'arbre avec ses feuilles pleure
Des pleurs larges tombés par les pâles midis
Et par les minuits clairs qu'un rai de lune effleure ;
Pleurs larges, neige jaune aux ornières, tandis
Qu'y mettront tes pas lents un frôlement de soie
Dont fuira l'essaim noir des corbeaux alourdis ;
Pleurs larges reparus dans l'or des feux de joie
Que brûlent à la fois trois bûches de Noël
Quand la famille au soir près de l'âtre s'éploie ;
Pleurs larges effarés quand la rage du ciel
Hurlant aux volets clos et dans la cheminée
Interrompt l'aïeul dans son conte habituel...
Que tes yeux voient déjà la campagne fanée,
L'aube retardataire et les soirs attristants
Vite venus, disant qu'agonise l'année ;
Puis prépare-toi pour les songes mal contents
Que t'apporte le froid comme aux vieilles branlantes
Malgré ta joue où luit le rouge des vingt ans,
Car voici s'avancer les heures lentes, lentes...
J'aime cheminer par mes prés normands,
Le long des talus et dans l'herbe drue :
Un vol abattu de moineaux gourmands
S'échappe aussitôt ma tête apparue ;
L'arbre craque au vent comme fait un mât
Et, sous les pommiers où plus rien ne bouge,
La branche me jette une pomme rouge
Qui tombe à mes pieds avec un bruit mat.
L'automne a rongé la campagne immense,
Un gros corbeau noir passe sur les houx ;
Les cieux sont plus bleus, les sentiers plus roux ;
Et, le long des eaux du ruisseau qui danse,
L'herbe humide fait un liseré vert.
J'aime errer aux prés avant que l'hiver
Ait englouti dans sa grande hermine,
Seule, me sentant un coeur de gamine,
Sans soucis, au gré des chemins tentants
Et causant tout bas avec mes vingt ans.
Je me suis accoudée à voir mourir l'automne
A mon petit mur bas, près du bruit monotone
De la source tombant dans le vert de l'étang,
Et d'où je vois les prés au bout desquels s'étend
La clarté de la mer entre les branches rousses.
Les oiseaux ont encor quelques notes très douces
Et remplissent tout seuls avec leur petit chant
La campagne où le jour traîne comme un couchant,
Tant y stagne d'ennui morne et de léthargie ;
Et, près de moi, l'été parti se réfugie
Tout entier dans le coeur d'une dernière fleur
Que pousse un dahlia simple, comme vainqueur
D'être, seule fraîcheur du dehors en désastre,
Plus rouge qu'une bouche, éclatant comme un astre.
Premier frisson de jaune aux verdures ; les haies
Sont riches d'avoir fait éclore tant de baies,
Rouges de baies
Et rouges d'oiseaux roux hôtes nombreux des haies.
Rouges-gorges tachés de rouge sous les cous,
Moineaux cuivrés parmi le sorbier et le houx,
Rouge le houx
Et rouges ces oiseaux tachés de rouge aux cous.
Sureaux aussi, régal des becs gourmands, et mûres
En grappes, et traînant, trempant dans les murmures,
Sureaux et mûres,
Des ruisselets courants pleins de menus murmures.
Eau qui clapote, envols et petits cris piquants,
Arbrisseaux, ruisselets, oiseaux, petits cancans
En cris piquants,
Grains dispersés du bec, poursuites et cancans,
Détournement du sombre où le rêve se plonge,
Tout le long de la haie en tumulte qu'on longe
Et qu'on relonge,
Ce petit monde intime et naïf où l'oeil plonge !...
Cet automne est si doux qu'on porte de la toile
Encor. Dans mes cheveux j'ai mis comme une étoile
Un chrysanthème, l'un des tout premiers éclos;
Puis je me suis penchée au petit mur du clos
En face des beaux prés que baise la mer bleue,
Les temples dans les poings, avec ma robe à queue
Enroulée à mes pieds, à voir, à pas très lents
Paître, sans relever leurs gros yeux indolents,
Les vaches aux deux pis gonflés comme des outres,
Les taureaux s'agacer les cornes dans les poutres
Et, redoutant la hâte automnale des soirs,
Sans bruit, rentrer au port parmi le roux des branches,
Le papillonnement sans fin des voiles blanches.
Et, seule, j'ai vécu dans la simplicité
Des choses, oubliant notre modernité
Complexe, détraquée, étrange, psychologue,
Une heure de soleil calme comme églogue.
Si tu viens à hanter le parc atteint d'automne,
Passe les yeux mi-clos sans chercher le détail
De chaque feuille chue ouverte en éventail
Sous les lourds marronniers où plus rien ne chantonne.
Ne suis pas du profond de l'oeil, sous d'autres troncs,
D'autres envols muets dans les clairières tues,
Ni l'arabesque au ciel des branches dévêtues,
Ni n'entends les corbeaux crier aux environs ;
Ne te retourne pas vers l'allée où peut-être
Ta traîne fit parmi les feuilles un sillon,
Et ne t'attarde pas en quelque station
Trop pensive à graver ton chiffre sur un hêtre ;
Puis, ne te penche pas à voir dans les étangs
T'apparaître à rebours le spectre de toi-même
Dans l'eau menteuse où dort un paysage blême
Que dérange le vent par coups intermittents ;
Même, n'allonge pas vers les dernières roses
Ta main qui les voudrait à ta bouche ou ton coeur,
Plus douces d'avoir fait éclater leur fraîcheur
Quand le dehors n'a plus que des choses décloses ;
Et quand tu reviendras t'asseoir au coin du feu,
N'y reste pas songeuse et la tête pendante ;
Rouvre le tome clos sur la page pédant,
Et que tout ton esprit s'y plonge peu à peu.
Car si ton pas s'attarde et si tu te reposes,
Si tes prunelles voient, si ton oreille entend,
Si ta face se penche au-dessus de l'étang
Et si ton geste va vers les dernières roses,
Et si, près du foyer où le silence dort,
Tu restes le front bas et les mains désoeuvrées
A voir l'allusion dans les flammes zébrées
Des feuilles de novembre aux larges chutes d'or,
Tu sentiras la fin s'achever dans ton âme
De tout ce qui se meurt au dehors: le beau temps,
La verdure, les champs, le chaud et tes vingt ans
Plus pesants à ton coeur qu'âge de vieille femme ;
Et vers la lune à l'heure où sans bruit elle sort
Du bois que lentement le lent automne oxyde,
Tu lèveras des yeux remplis de suicide
Et des bras déjà fous du geste de la mort.
Le soir tiède gémit aux gorges des chats-huants,
Du fond des bois fanés où chaque arbre détaille,
Sur un coin de couchant resté, toute sa taille.
Un gouffre simulé s'ouvre au fond des étangs
Où le ciel à rebours mire ses altitudes.
Les chutes de l'automne hantent les solitudes.
Or sur roux, roux sur jaune, il pleur légèrement.
Les marronniers y ont joint leurs feuilles plus larges,
Comme des éventails intacts, le long des marges...
Mais parmi l'ombre, ainsi qu'une bouche d'amant,
S'offre au baiser qui passe une dernière rose,
Pour ta caresse humide et doucement déclose.
Ta robe a épousé ton corps souple et pudique
Et sculpte de drapés tes moindres mouvements ;
Tant, qu'une allusion à quelque bucolique
Nous fait rêver en toi celle que des amants
Poursuivent par le bois automnal où tu erres,
Et qui rit et se cache au profond des clairières
Tout en laissant tomber une à une ses fleurs
Afin qu'ainsi, la découvrant, calme ses peurs
Le plus hardi de ceux que le désir talonne
De l'étreindre parmi les rousseurs de l'automne,
Eclatante de chair sans voile et de beauté...
Car, malgré l'étoffe où ton allure est tenue,
De n'avoir que ta robe aux hanches, tu es nue.
L'automne, bouquet mort qui s'effeuille sur nous,
Chante au luth des roseaux comme un refrain d'aède.
Le souffle d'un amant passe dans son vent tiède,
Rudoyeur d'arbres d'or à même les ciels fous.
Des feuilles choient ; la mer en roule dans ses vagues ;
Celles des marronniers rouent parmi les chemins;
La journée est un long crépuscule... Ah ! des mains !
Tendre des mains de rêve opulentes de bagues
Vers on ne sait quel songe immense ; et en sentit
Qui vous prennent ; et fuir dans leur force qui noue
Vers là-bas, vers très loin, à jamais joue à joue
Avec quelqu'un qui soupirait dans ce soupir
Des roseaux, dont le souffle en la brise était tiède
Et qui hantait les bois de cette âme d'aède !...
Lentement, vers l'automne artiste qui dévêt
Une nature fine et architecturale
Dont depuis si longtemps notre regard rêvait,
Courte en midis et si longuement vespérale,
Lentement, nous irons bien loin de nos maisons.
Les feuilles cherront une à une ou à poignées.
Nous suivrons, jusqu'à la clarté des horizons,
Eclaboussés du sang des arrière-saisons,
Les prés où furent nos plus chères promenées.
Energique de la torsade des troncs forts,
Les uns encor feuillus, les autres déjà morts,
L'automne flamboiera dans des couches féroces
De rouges et de noir contredits durement
A travers le détail de son ramifiement.
Il neige d'or au vent qui frissonne ; et les cosses
Eclatent sous les pieds d'or d'où roulent les marrons !
dans l'herbe, vont tomber quand nous y marcherons
Au fond des prés, avec un choc, les pommes grasses.
Mais le long de la source, à sentir que tu passes,
Les roseaux vont frémir tous ensemble et chanter
Comme aux mains d'un berger une harpe rustique ;
Car l'âme de l'automne, ô triste ! à ta beauté
Donne ce rendez-vous pastoral et pudique...
Je voudrais évoquer à cause du printemps
Quelque rêve fleurant la joie et la tendresse
Où flâneraient des pas d'amant et de maîtresse
Ivres de leur amour et de leurs beaux vingt ans.
Car voici sur le bleu des ciels les aubépines,
Roses bouquets perdant au vent par millions
Leurs pétales mêlés au vol des papillons
Légers plus follement qu'un pas de ballerines.
Car voici susurrer les sursauts clapotants
Des ruisseaux clairs en qui ne dort aucune lie,
Et se mirer déjà quelque longue ancolie
Comme une étoile au fond du glauque des étangs.
Car voici les pigeons aux saluts réciproques,
Le cou gonflé d'amour et de roucoulement,
Et, comme un éventail étalé largement,
Ouvrir leur roue énorme et riche, les paons rauques.
Car les échos moqueurs aux gorges des coucous
Et les rires aigus d'hirondelles alertes
Et les cris des gibiers au sein des ombres vertes,
Tous les refrains qui sont au fond de tous les cous,
Tout ceci, tout cela, l'eau qui court, ce qui passe,
Le vent et la nuée en haut et le sous-bois
Et les champs et la route et les fleurs et les voix,
Toute cette harmonie et toute cette grâce,
C'est l'accompagnement haut et bas tour à tour
Qui soutient le duo de l'homme et de la femme,
C'est tout le renouveau chantant l'épithalame
Pour l'auguste union d'un couple dans l'amour !
L'âme et la mer
Je te salue, ô mer, éternelle fantasque,
Caressante et brutale ensemble ou tour à tour,
Qui sait chanter le calme et hurler la bourrasque,
Etre comme en fureur et puis comme en amour !
Tandis que jusqu'à moi qui te vois seule à seule,
Avec le rythme doux de quelque immense luth
Tu roules des rochers fracassés sous ta meule,
Mystérieuse, belle et puissante, salut !
O trouble ! ô double ! ô charme enjôleur, grande glauque
Attirante à jamais par tes complexités,
Enveloppe-moi toute avec ton souffle rauque
Dont les visages sont baisés et souffletés,
Amène à mon assaut ta brise qui m'éreinte
Et te fait follement écumer aux brisants :
Je veux te quitter lasse ainsi qu'après l'étreinte
La maîtresse s'arrache aux bras trop épuisants ;
Surtout, allonge-toi jusque sur ma semelle,
Car, ô perverse ! il faut me rendre mes saluts,
Parce qu'en moi je porte une âme, ta jumelle,
Capable comme toi de flux et de reflux,
Une âme comme toi variée et profonde
Et riche comme toi de trésors ignorés
En qui, croyant pouvoir y jeter une sonde,
Beaucoup sont et seront à jamais chavirés.
Car, vierge, me voilà devant toi, grande vierge,
Vierge sur qui le ciel est toujours suspendu,
Miré par toi, roulé par tes eaux sur ta berge,
Mais qui fut jamais en toi pourtant n'est descendu.
Car je t'aime, et , sentant, pleine de ressemblances,
Ta marée envahit tout mon être béant,
Je veux mêler ma voix aux éclats que tu lances,
Le geste de mes bras à ton spasme géant.
Viens ! que m'importe au fond que ta surface mente,
Que ton flot monte à moi gonflé de trahisons ?
J'ai de l'énigme en moi plus, ô mer ! mon amante,
Qu'il n'en pourrait tenir dans tes quatre horizons !
Les nuages sereins stagnant au-dessus d'elle
L'ont couverte, la mer, tout le long de ses eaux :
Là, d'une ombre de citadelle,
Plus loin, de mille toits, tours, temples et châteaux ;
Et la mer, qu'elle soit basse, haute ou étale,
Berce une ville capitale
En ombre et que jamais les yeux ne pourront voir.
Et les grands peupliers ont une ombre si grande
Dans l'herbe où va ton nonchaloir,
Qu'elle suit tout le pré de son étroite bande,
descend la falaise et s'allonge dans la mer
Où tremble ainsi, eux si lointains, leur faîte vert.
Et ton ombre est couchée aussi parmi les vagues,
Sirène noire et qui tend à tes bras tendus,
Comme une allusion aux baisers défendus,
L'impossible plaisir de ses étreintes vagues...
Mer, je t'entends monter du fond de l'horizon,
Comme pour engloutir le monde;
Mer, je t'entends monter du fond de l'horizon !
Grosse de la fureur que chaque lame gronde,
Ta grande voix nocturne a franchi la maison,
Grosse de la fureur que chaque lame gonde.
Tandis que le sommeil vient pire qu'un poison
M'apporte ses plus affreux rêves;
Tandis que le sommeil vient pire qu'un poison,
O toi ! hurle plus fort encore sur les grèves,
Que je t'entende même au fond de l'oreiller,
O toi ! hurle plus fort sur les grèves !
Car moi je vais dormir et toi tu vas veiller,
Chantant de toute ta marée,
Car moi je vais dormir et toi tu vas veiller.
Ta berceuse sera rude et désespérée ;
Soufflant l'horreur sans trêve et sans rémissions,
Ta berceuse sera rude et désespérée,
Racontant les Saphos sanglotant leurs Phaons
Du haut de Leucades farouches,
Racontant les Saphos sanglotant leurs Phaons,
Les veuvages en deuil criant par mille bouches,
Les croix de mort le long de tes rivages roux,
Les veuvages en deuil criant par mille bouches,
Les naufrages et les dégâts, tous tes courroux,
Toute ta sombre souvenance,
Les naufrages et les dégâts, tous tes courroux, !
Chante et je dormirai comme au temps de l'enfance
Avec ton chant barbare enflant l'obscurité,
Chante et je dormirai comme au temps de l'enfance,
Avec l'illusion d'une âme à mon côté.
Arrêtée, accoudée à te voir, mer nocturne,
Tandis que traîne au ciel un reste de couchant,
Je t'écoute rouler ton flux ainsi qu'un chant
vers ma pose immobile et mon front taciturne.
Au fond du parc, les fleurs ferment leurs encensoirs,
Mais dans l'obscurité qui s'avance avec l'heure,
O claire ! à l'horizon ta lumière demeure,
Comme une grande perle entre les arbres noirs.
Et, tout l'être baigné de nuit, seule invisible,
Oubliant les présents, les hiers, les demains,
J'adore, alors le front tombé dans mes deux mains,
L'Infini que, là-bas, clame ta voix paisible...
Je promène au dehors mon exaltation
A grands yeux, à grands bras lyriques,
A grandes ailes chimériques
Par lesquelles je sais plus d'une assomption.
Robe ample au vent collée à ma beauté charnelle,
Cape qui claque autour de moi,
Toute ma vêture en émoi
Met autour de mon corps le battement d'une aile.
Je viens à des brisants lourds à même la mer ;
Elle y monte, bat, bave, mouille,
Y plaque ses varechs gluants, comme une rouille,
Y crache son embrun amer.
J'y reste seule en sa présence,
Infime qu'une vague emporterait si bien !
A voir, plus docile qu'un chien,
Se rouler à mes pieds cette toute-puissance.
Chaque lame prend son élan,
Grince aux galets, recule à trois pas, se recrée
Aussi forte qu'une marée,
Et remonte à l'assaut de mon socle tremblant.
C'est une éternelle magie
Où la mer, en cadence ou par coups furibonds,
Pleure et chante à la fois dans son calme et ses bonds
Sa mollesse et son énergie.
Mais moi, les poings crispés à mes deux flancs raidis
Sous l'étoffe qui les enlace,
Devant toute la mer qui monte et qui menace,
La bouche ouverte, je le dis,
Je le hurle, je le déclame
Dans le vacarme affreux que font ces flots vivants,
Dans la rage des quatre vents :
Le tourment de la mer est au fond de mon âme !
Quand le couchant se meurt dans tes eaux vespérales,
Mer, en passant le long de tes vagues, j'entends
Rôder en toi le choeur des âmes ancestrales
Qui, de même que moi, te hantèrent longtemps,
Les poétesses et immortelles maîtresses
A qui pesèrent trop leur coeurs gros de tendresses,
Ames païennes, âme étrange de Sapho
Hurlant d'amour et de génie avec ton flot...
Mer ! mer ! je sens aussi que mon âme en démence
Grandit en moi pareille à ta marée immense ;
J'ai mal de me sentir semblable à toi ! Mer ! Mer !
Prends-moi donc ! Roule-moi dans ta force, âme et chair,
Pour que je puisse aussi par tes sombres vesprées
Crier comme Sapho dans la voix des marées !
Je ne peux plus rester les paumes à la temps,
Philosophe au front clair dont traînent les cheveux
Sur l'in-folio grave et le tome poudreux,
Dans le silence où tremble et crépite la lampe ;
Je ne peux plus forcer ma pensée à veiller,
Fleur humide tombée aux pages du grimoire,
Ni lasser ma raison, ni forcer ma mémoire
Fiévreuse, bien après l'heure de l'oreiller.
Que les feuilles au loin se meurent une à une,
Choient toutes dans l'étang trouble, glauque et sans cours,
Ou que les chats-huants appellent au secours
Dans le chien-et-loup triste où naît déjà la lune,
Que le dehors atteint se fane lentement
Sous le ciel qu'envahit l'émeute des nuages,
Je lèverai pas le chef de sur les pages
Ni ne m'interromprai de mon raisonnement ;
Mais tu houles là-bas en proie à l'équinoxe,
Et ta voix furieuse a franchi la maison,
Et, mieux que les beautés de l'arrière-saison,
M'arrache du dilemme âpre et du paradoxe,
O toi ! mer désolée et soeur de mon tourment,
Mer que contient en soi ma faiblesse de femme,
Mer qui me fais trop ample et trop lourde mon âme
Où tu bats tout entière inguérissablement.
Oui, je refermerai le livre, mer natale,
Manche grise ! Et j'irai vers tes cris et tes chants,
Vers les falaises, vers tes tragiques couchants,
Seule et le front baissé comme une ombre fatale.
Je ne regretterai la lampe ni le toit ;
Le vent fera claquer ma robe monastique,
Je mêlerai ma voix à ta voix emphatique
Et j'ouvrirai mes bras inassouvis vers toi.
Et les lames du bord qui se dressent en barre
Et ton large en désastre et ton grand souffle amer
Gourmanderont mon âme et calmeront ma chair
Mieux que le livre et mieux que l'étude, ô barbare !
Ah ! chante, chante-moi tes rythmes violents !
Chasse tout ce qu'en moi je hais et j'abomine,
Ces rêves de baisers où l'âme s'effemine,
Ces tendresses qui font les esprits indolents !
Ah ! cingle, frappe, mords de ta sainte rudesse
L'adulte chair qui songe à de la volupté,
Car je me veux pudique en ma virginité,
Moi ta folle, orgueilleuse et sombre poétesse !
(Je suis la hanteuse...)
Je suis la hanteuse des mers fatales
Où s'échevèlent les couchers sanglants,
Des mers basses ou hautes ou étales
Vers qui je crie du profond de mes flancs.
Ma solitude orageuse s'y mêle
Au désert du sable vierge de pas
Et où, sans craindre d'oreille, je hèle
Je ne sais quel être qui ne vient pas...
Oh, la mer ! la mer ! Toi qui es une âme,
Sois bonne à cette triste au manteau noir,
Et de toute ta voix qui s'enfle et clame,
Hurle ta berceuse à son désespoir !
Que ta toute-puissance en colère déferle
Ou se meure en pâleur dans les couchants éteints,
laiteuse dans les soirs comme une grande perle
Ou bleue ou noire au coeur des midis et matins,
O Toi matinale ! ô vespérale ! ô nocturne !
Quelle que tu sois, flux qui monte ou redescend,
Toi que j'ai mariée à mon coeur taciturne,
A tout ce qui me bat dans l'âme et dans le sang,
Manche française, mer normande, mer natale !
Grisaille coutumière au bout des horizons,
Douce à la chair et douce à l'âme occidentale,
Chère à nos prés verts, souffle et voix de nos maisons,
Je t'aime, dans ta grande et mystérieuse oeuvre
De houle et de repos alternants, et je viens,
Je cours à toi qui loin, qui près m'attires, pieuvre !
Glauque étreinte qui veux nos corps pour tes liens !
J'aime en la flore dont ta profondeur regorge
La sirène des clairs et froids sptentrions
Etrange et toute prête à nous prendre à la gorge,
Qui rit à fleur des eaux pour que nous y courions.
J'aime l'existence alme et grouillante et si chaste
Dont tu vis chastement, pudique qui te fonds,
Gaie ou mineure, en chants, dans le registre vaste
De cette sphinge occulte au guet sous tes tréfonds.
Je t'aime, àme des yeux, regard clair des prunelles,
Comme j'aime les yeux, comme j'aime des yeux
Féminins que j'ai vus, dans des faces charnelles,
Ruisseler tous tes verts, tous tes gris, tous tes bleus.
Et tu es belle, ampleur rude et préhistorique,
Pareil spectacle aux sens modernes qu'aux anciens,
Splendeur invariée, incorruptible rite,
Caprice que n'a pu l'homme plier aux siens.
Primordiale, libre, ô libre ! et toujours vierge,
Je veux t'aimer, je veux te hanter pour t'aimer
Et coucher mollement le rêve, sur ta berge,
Que tu sais si bien mettre en musique et rythmer !
O toi qui nous endors du sommeil hypnotique
Des iris large ouverts parmi tes mouvements,
O toi flot de l'enfance, ô toi berceuse antique
Où rauque sourdement l'âme des éléments !
Silencieuse et seule avec mon rêve amer,
Au fond de mon âme démente,
J'entends que se lamente
Toute la mer.
Elle y souffre le mal de ne pouvoir se taire,
D'être changement, mouvement,
Anxiété, tourment,
Horreur, mystère !
Elle y pleure qu'elle est insondable et sans bords,
Qu'elle roule, étrange et perverse,
Sous sa face diverse,
Tous les remords.
Elle y hurle que c'est en vain qu'elle fascine,
Que l'on devrait en avoir peur,
Que son charme est trompeur,
Qu'elle assassine !
Et cet appel, surtout, de tous ses rythmes fous
Vers le ciel qu'elle ne peut prendre,
Se mirant sans descendre
En son remous !
Ah ! cette plainte égale et double qui déclame !
Ce semblable flux de sanglots !
Ah ! tous les tristes flots,
Toute mon âme !
Une voix sous-marine enfle l'inflexion
De ta bouche et la mer est glauque tout entière
De rouler ta chair pâle en son remous profond.
Et la queue enroulée à ta stature altière
Fait rouer sa splendeur au ciel plein de couchant,
Et, parmi les varechs où tu fais ta litière,
Moi qui passe le long des eaux, j'ouïs ton chant
Toujours, et sans te voir jamais, je te suppose
Dans ton hybride grâce et ton geste alléchant.
Je sais l'eau qui ruisselle à ta nudité rose,
Visqueuse et te salant journellement ta chair
Où une flore étrange et vivante est éclose ;
Tes dix doigts dont chacun pèse du chaton clair
Que vint y incruster l'aigue ou le coquillage
Et ta tête coiffée au hasard de la mer ;
La blanche bave dont bouillonne ton sillage,
L'astérie à ton front et tes flancs gras d'oursins
Et la perle que prit ton oreille au passage ;
Et comment est plaquée en rond entre tes seins
La méduse ou le poulpe aux grêles tentacules,
Et tes colliers d'écume humides et succincts.
Je te sais, ô sirène occulte qui circules
Dans le flux et reflux que hante mon loisir
Triste et grave, les soirs, parmi les crépuscules,
Jumelle de mon âme austère et sans plaisir,
Sirène de ma mer natale et quotidienne,
O sirène de mon perpétuel désir !
O chevelure ! ô hanche enflée avec la mienne,
Seins arrondis avec mes seins au va-et-vient
De la mer, ô fards clairs, ô toi, chair neustrienne !
Quand pourrai-je sentir ton coeur contre le mien
Battre sous ta poitrine humide de marée
Et fermer mon manteau lourd sur ton corps païen,
Pour t'avoir nue ainsi qu'une anguille effarée
A moi, dans le frisson mouillé des goëmons,
Et posséder enfin ta bouche désirée ?
Ou quel soir, descendue en silence des monts
Et des forêts vers toi, dans tes bras maritimes
Viendras-tu m'emporter pou, d'aval en amonts,
Balancer notre étreinte au remous des abîmes ?...
Le faste ni l'attrait des villes et des terres
Ne me feront, ô mer lointaine ! t'oublier:
Car, tout entier, j'entends, par bonds ou régulier,
Ton flot capricieux battre dans mes artères;
Car je sens fulgurer encor mes larges yeux
D'avoir tant contemplé tes horizons en flamme;
Car tes rythmes me sont restés au fond de l'âme;
Car ton souffle a laissé du vent dans mes cheveux.
Et, par les minuits noirs, assise sur ma couche,
Lorsque je songe à toi tout bas, seule en éveil
Parmi l'universel silence du sommeil,
Mon âme sort de moi comme un spectre farouche,
Et ce spectre s'en va rôder dans ton fracas
Et, tel qu'une Sapho hantant quelque Leucade,
Dans des mots furieux que le sanglot saccade
Se plaint de sa souffrance en se tordant les bras.
Mon âme vit en moi comme un dieu solitaire,
Sans espoir désormais et doublement banni
Pour avoir vainement crié vers l'Infini
Sans que l'aient consolé les bonheurs de la terre.
Et mon âme parfois plus qu'à d'autres moments
Souffre de s'être ainsi close sans rien connaître
Des pitiés en qui s'abreuve tout notre être
Ou du profane amour dont pâment les amants.
Je ressuscite alors de très vieilles chimères,
Rêvant de je ne sais quel être à qui m'unir,
De je ne sais quel sein bon et tendre où venir
Sangloter je ne sais quelles peines amères.
Mais la prière expire à mes lèvres ; mes bras
Elevés vers le ciel se tordent dans le vide
Et l'âme humaine n'offre à mon regard avide
Qu'un lieu fermé portant ces mots: "On n'entre pas !"
Ah j'étouffe ! Le poids de cette solitude
M'écrase et me meurtrit malgré tous mes efforts,
Malgré le rythme en qui je me berce et m'endors,
Malgré le livre ouvert, malgré l'art et l'étude.
Et je t'évoque, toi si lointaine aujourd'hui,
Mer natale, ô ma belle et grandiose amie
Qui seule fis parfois mon angoisse endormie,
Vers qui toujours mon coeur douloureux me conduit.
Toute seule devant ton flot pendant des heures,
Je voudrais promener mon silence anxieux
Et, puisqu'il n'est jamais de larmes dans mes yeux,
M'écouter longuement pleurer lorsque tu pleures,
Ou bien, parmi la nuit, le fracas et le vent,
A l'heure où ta tempête est à son apogée,
Crier en toi, sauvage, affolée, enragée,
Les cheveux dénoués et les poings en avant.
Paroles
I
Laisse-moi, le regard sur toi, t'apostropher,
Bébé vers qui se tend ma poigne qui frissonne
Songeant que mes dix doigts sur ta frêle personne
Ne mettraient que si peu de temps à l'étouffer.
Masse qui vit, tu n'es pour d'aucuns, pour d'aucunes
Surtout, qu'une pelote amusante de chair,
Petit corps à manger de baisers, être cher,
Etre exquis ! Et jamais tu ne les importunes.
Que de lèvres iront frôler ta joue en fleur !
Que de cajôlerie et que de pomponnage,
Que d'attendrissments entoureront ton âge,
Que de regards luisants d'un maternel bonheur !
Ta bouche en qui surtout le futur verbe dort,
Tes oreilles qui n'ont entendu nulle chose,
Et ton front sans pensée et tout ton masque rose
Où n'a pas grimacé la vie humaine encor.
Ah ! quel mystère es-tu, fraîcheur, candeur, enfance
Molle en ta rondeur prise à quelque oeuf primitif
Et tout inerte encor du néant productif
Où s'engendre à jamais l'éternelle existence !
Ah ! de songer tout bas, petit inconscient,
Qu'un jour, de cette bouche étalée en corolle,
Naîtra ce monde énorme, effrayant : la Parole ;
Qu'une âme habitera ton regard innocent ;
Que tes deux bras ballants exprimeront le geste,
Que tes deux petits pieds multiplieront des pas,
Que tu verras, ouïras, retiendras, rediras,
Petit infirme, quand l'âge t'aura fait leste :
De penser tout cela devant ton front qui dort,
Ame à souffrance et chair à souffrance accouplées,
Enfance qui détiens en tes lèvres scellées
Un secret aussi noir que celui de la mort,
O bébé ! C'est cela qui fait mon épouvante
Au moment où je t'ai tout vivant dans mes bras ;
C'est tout cela qui fait que je ne t'aime pas
Quand chacun près de moi te dorlote et te vante,
Car, devant le poupon aux charmes éternels
Pour lequel à jamais s'extasieront les mères,
Mon sombre coeur de femme en ses fibres amères
Ignore le frisson des amours maternels ;
C'est que je hais la vie avant de la connaître
Et que, dans cet enfant, posé sur le pavois
Pour l'adoration féminine, je vois
La reproduction détestable de l'être...
Pauvre petit bébé ! dans ton nid ouaté,
Quelle pitié voudrait, d'une main inconnue,
Serrer un peu trop fort ta petite chair nue,
O germe, ô lendemain, future humanité ?
Le grand Tout le Monde, et ces mains qui le travaillent
Comme une glaise informe où l'oeuvre surgira,
Les oisifs et ceux-là qui taillent et retaillent,
Tous, des noms les plus hauts jusqu'aux et coetera,
L'intégral Aujourd'hui, science, art, rêve farouche,
Laborieusement pour le demain accouche.
Nous voici donc, nous la ténèbre et le rayon !
Vanités, nullités, vous, misère, ignorance,
Egoïsme, mal, vice, immense bataillon,
Toute la brute humaine horrible de souffrance,
Horrible de bassesse, horrible de laideur,
Porte son faix et prend part au dur labeur
Car, ô les grands meneurs, ô les fronts lumière
Et vous, l'habileté subtile des dix doigts,
C'est dans, par cette énorme et stupide matière
Que flamboient vos cheveux et que clament vos voix ;
Artistes, c'est parmi ces tourbes dégoûtantes
Que se tordent vos fleurs, les plus exorbitantes.
Le creuset de l'idée est empli jusqu'au bord,
La substance y bouillonne, inconscient, et s'y moule,
Le joailler y met sa perles; et de l'effort
De nous tous, contenant l'âme de notre foule,
Monument orgueilleux et commémoratif
Sort: le vase brillant, serti, définitif,
Le calice d'or pur gemmé de pierrerie,
Métal de la pensée et du progrès fécond,
Joyaux luisants de l'art et de la rêverie
Tirés du minerai de la masse sans nom
Et que nous fûmes, ô toi ! pérennité humaine !
Car notre siècle tend les mains pour te l'offrir,
Voulant que l'avenir penché sur ce ciboire
S'enseigne, y apprenant - devant vivre et mourir
A son tour - quelle fut notre façon d'u boire
Le breuvage obligé fait de miel et de fiel
De notre part de vie humaine sous le ciel.
Trois trilogies
Trilogie de la vie et de la mort
I
Je crisperais aux draps mes poignes refermées
Et, pleurant par ma chair la dernière sueur,
J'expirerais, l'oeil plein de la suprême peur,
La bouche ouverte encor par les affres pâmées.
La pâleur sculpturale et calme des camées,
Alors, envahirait mon masque sans chaleur;
Et, sans âme, sans plus jamais de rythme au coeur,
Je dormirais parmi les cires allumées.
Ah, mourir !... Si mon corps sous le marbre poli
Se reposait, tout jeune, avec la fleur d'oubli
Vite poussée au coin de la croix protectrice,
Où serait l'être ? vers quel lointain Quelque part,
Lorsque se referait la terre productrice
Avec ce qui fut voix, attitude et regard ?...
Pas de mort tôt venue et de cierge qui brille,
Lent et chaste au côté de la vierge qui dort;
Mais le dos que le poids de l'existence tord,
Mais la face où le temps marque son estampille.
Débris que tient debout la canne et la béquille,
La vieillesse, en un mot, plus triste que la mort,
Peut me faire, à la fin de ce suprême effort,
La vie, aïeule blanche ou bien très vieille fille.
Et j'irais par le siècle, égarée et sans lot,
Gardant la peine au coeur, le dégoût, le sanglot
D'avoir perdu la vie et d'être encor sur terre ;
Avec le navrement des désespoirs vécus
dans les yeux, je serais l'ambulante misère,
La laide, qu'à sa mort nul ne pleurerait plus.
Vieillesse vacillante et triste ou fin hâtive,
L'une d'elles doit donc m'atteindre sûrement,
Et je me sens le coeur pris d'épouvantement
A songer qu'il faudra que je meure ou je vive.
Fantômes dont chacun à mon côté se rive,
Ces deux destins me font horreur également,
Tous deux étant l'atroce et lent dépouillement
Qui nous prend morts ou bien à même la chair vive.
N'existe-t-il aucun Refuge où s'échapper ?
Nulle épaule où pleurer ? nulle porte où frapper
Quand le coeur est tordu par la détresse noire ?
... Etre et ne pas savoir ce qu'on est ; ni pourquoi
L'angoisse d'exister quand le suprême effroi,
Le Peut-être, est au bout du chemin... Croire, oh croire !...
L'innomable, le seul, l'éternel, l'Absolu
Reste immuablement le sommet et la base
De l'être, n'attendant nulle future phase,
Pour qui le temps, jamais, ne sera révolu.
Et, vers le grouillement d'êtres qu'il a voulu,
Mal vivant qui parmi l'univers s'extravase,
Il ne peut se pencher que par une hypostase
Qu'entrevoit seulement quelque sublime élu.
Cependant que, sans fin, la meute s'exaspère
Des foules qui, devant cette énigme du Père,
Hurlent de désespoir, de doute et de terreur,
Et que les pitiés se taisent, infécondes,
De crainte que l'appel infime de leur coeur
Ne se perde à jamais dans le remous des mondes.
Mais voici que, parmi l'horrible bacchanal,
Le Père engendre un Fils infiniment auguste
Dans le but de laisser à l'humanité fruste
L'exemple de son être aimable et virginal.
Les yeux levés, au cours de son chemin banal,
Au ciel d'où semble choir chaque hasard injuste,
Il travaille, ridant ses mains, ployant son buste
Voués pour récompense au supplice final,
Voulant, hôte du monde haineux, vil, triste, obscène,
Traversant, os et chair, sa scandaleuse scène,
Douer d'âme et de coeur ses vivants mannequins
En leur montrant, par sa douceur à leur souffrance,
La part docile prise à leurs labeurs mesquins,
Comment vivre en courage, en bien, en espérance.
Mais ensuite, parmi la foule qui proteste,
Raillé sans fin, non cru sauf des douze et honni,
Tout l'être illuminé d'un reflet d'Infini,
Le Fils dit l'ère neuve au monde impie, et teste.
Et, joignant à jamais le ciel à l'homme, reste
- Ce pourquoi son époque entière l'a puni, -
L'éclair qui fit divin l'être du rabboni
En passant par sa voix, son regard et son geste,
L'Esprit (prière, extase, appel), assomption
De l'âme avant le temps de résurrection
Vers la source promise à la Samaritaine,
Dont elle redescend prête à mieux obéir,
Ayant renouvelé dans sa course lointaine
Le vouloir effrayant de vivre sans faillir.
Trilogie du parti à prendre
Un jour, tu sentiras ton âme fiancée
Au grand, avec l'instinct dès lors jamais ôté
D'aller se consoler au sein de la beauté
De tout ce qui la fit douloureuse et lassée.
Or, tu verras le monde autour de toi ; poussée
Coude à coude, cohue où la banalité
Domine, où l'implacable et froise vanité
Finit par pervertir toute haute pensée.
Alors tu rêveras de quelque grand lointain
Tranquille, grave, pur d'ambitions pareilles,
Où fuir les yeux fermés, les paumes aux oreilles,
Pour, heureux du Refuge à tout jamais atteint,
Y reposer ton coeur et ton âme amoureuse
De calme, hors du bruit de l'existence creuse.
Ton âme cherchera l'issue où s'en aller,
Alors, et, prise encor dans le chaos des choses,
Avide de monter vers des apothéoses,
Ses ailes s'ouvriront larges pour y voler ;
Et tu croiras, ainsi qu'un souffle, t'exaler
Et, comme un aigle plane au fond des couchants roses,
Tu croiras t'élever jusques aux portes closes
De l'Au-delà pour toi prêt à se desceller.
Mais tu redescendras de tes grands crépuscules ;
Mais tu renonceras aux luttes ridicules
De ton infimité contre l'éternité.
Haïssant encor plus ton humaine atmosphère,
Haïssant l'Infini pour t'y être heurté,
Tu resteras béant à ne savoir que faire.
Oublie alors l'instinct dont ton âme est la proie ;
Brise la force en toi qui s'en va vers l'aimant ;
Et que l'extérieur des choses seulement
Suffise désormais à te donner la joie.
Sois heureux du couchant splendide qui flamboie
Sans vouloir marier ton âme au firmament ;
Tâche d'aimer le beau sans être son amant,
Sans te laisser troubler des charmes qu'il déploie.
Donne tout ton effort pour prendre ce parti ;
Renonce à ce projet qui n'a point abouti
De trouver un asile où ton âme s'isole ;
Renonce à t'obstiner dans ton rêve ; sinon,
Après quelques essais, tends à la camisole
Tes deux poings impuissants, et meurs au cabanon !
Léviathans au coeur de pierre aux coeurs vivants, ô villes !
Oeuvres d'orgueil qu'attend l'effondrement final,
Hors de votre tumulte et de vos choses viles,
Hors de vos longues nuits noires et sans fanal,
A jamais est offerte à l'âme solitaire
Qui n'a pas pu trouver l'épaule où sangloter,
tel qu'un giron humain, la douce et bonne terre
Ouvrant ses bras à qui veut s'y précipiter.
Ah ! donne-nous tes fleurs à presser sur nos bouches
Comme des baisers frais pour nos baisers fiévreux ;
Laisse-nous manier dans nos poignes farouches
Tes foins rudes qui font songer à des cheveux ;
Emplis de tes parfums la narine béante ;
Revêts d'ombre le corps qui veut porter le deuil,
Livre-toi tout entière à nos deux bras, géante
A la taille de qui nous grandit notre orgueil !
Patiente qui sais sans en être lassée
Attendre nuit et jour le tribut qu'on te doit,
Toi qui ne nous mens point, ô notre fiancée !
Nous voulons t'embrasser et nous coucher sur toi,
Pour, d'avance évoquant sos siestes éternelles
Versant comme en amour des pleurs en océan,
Dans un spasme profond des poussières charnelles
Nous tordre de désir vers ton prochain néant !
Ceux-là, tous ceux-là, gros d'écoeurantes essences,
Pesants de leur banalité coupable ; aux yeux
Arrondis salement sur les concupiscences,
Langues lasses d'avoir médit, cerceaux terreux
Bondés d'horreurs: plaisir médiocre, facile
Vanité, bas trafic, égoïsme imbécile,
Ceux-là, le Tout le Monde, en un mot, actuel,
Farandole du jour le jour, foule asservie
Au culte des conventions, au rituel
Du préjugé, bigots des routines, leur vie
A ceux-là, n'a pour but et pour combinaison
Qu'elle-même d'un bout à l'autre... Ils ont raison.
Nous ne sommes que des fous parmi ces lucides,
Ils vivent l'existence humaine comme elle est,
Ils ne lèveront par leurs prunelles placides
En haut, ne souffriront ni du mal, ni du laid,
Ne demanderont pas pourquoi tourne la roue;
Mais, contents de marcher les deux pieds dans la boue,
Ils suivront leur chemin terrestre sans écart,
Ne cherchant jamais plus en l'être que la vie,
Et c'est nous, les grands bras tendus, nous le regard
Toujours en l'air et vers ce qui nous fait envie,
Nous les amants de l'impossible, nous ces fous,
Qui perdrons l'équilibre et cherrons dans les trous.
Toi qui, dans les ébats de la mauvaise joie,
Qui, dans la vanité des vanités, descends
Rôdes, flairant, guettant en silence ta proie,
O toi l'hommage, ô mort ! le salut et l'encens.
Je veux fêter sans fin ton masque épouvantable
Qui sans bouche ricane et sans yeux voit; tes mains
Si maigres, maniant la faulx inévitable
Dans l'ébaudissement stupide des humains:
Car je t'aime en songeant qu'un jour, bonne passante,
Tu viens nous délivrer de l'ennemi de chair
Qui fait ramper, dans la besogne avilissante
D'exister ici-bas, notre esprit pur et clair;
En songeant que tu viens l'assassiner, le prendre
au col, ce corps qui tient notre essence en prison,
Et que ta poigne alors l'oblige de s'étendre
Muet enfin, sans phrase et sans bonne raison,
Lui par qui fut notre âme, ainsi qu'un aigle en cage,
Incapable de vol vers le suprême Beau,
La dépouille l'ayant en soi, comme un otage,
Gardé jalousement jusqu'au jour du tombeau.
Viens nous en arracher de cette triste écorce,
Viens libérer le dieu que son étau meurtrit,
Prononcer à jamais le bienheureux divorce
De cet accouplement de matière et d'esprit,
O toi la fiancée éternelle et sans joues,
Toi la promise à tous, l'Amante, qui permets
Que nous sortions enfin de nos infâmes boues,
Et vers la vie, ô mort! nous portes à jamais !
L'âme de ceux qui sont ou seront, l'âme étrange
Et hautaine en qui couve un terrible avenir,
Naît dans les coeurs amers, sous des fronts qu'elle mange,
Et dans des corps déjà las de la contenir.
Elle est pesante d'utopie et de chimère,
Soulevée en l'effort immense de ces temps
Vers de la vérité vraie et de la lumière,
Et hurle dans le vide en pourquois haletants.
L'art y est convulsé dans l'horreur du symbole,
Tordant le geste fou de ses deux grands bras nus,
Pleins de menace et de haineuse parabole,
Sur un sinistre fond d'horizons inconnus.
La musique y prolonge un sanglot, y détonne
Sa dissonnance rauque et son chaos puissant,
Et la poésie âpre y dresse sa gorgone
Furieuse, aux deux yeux qui ruissellent de sang.
La volontaire, la cruelle Idée y forge
Sa logique féroce et pure, et, de ses mains,
Cherche comment serrer le vieux monde à la gorge,
Vivant qui barre encor la route des demains.
L'humanité, le poing au drapeau des révoltes,
Ainsi toute levée en l'âme d'à présent,
Court, grosse des fureurs de sa raison, les voltes
Multiples de son pas tragiquement pesant.
Mais nous, lourds de cette âme ample qui s'évertue
Pour accoucher du songe énorme qui l'emplit,
Rêvons, ayant jeté son fardeau qui nous tue,
Au dormir éternel de notre dernier lit...
Notre pensée intime est un vaste royaume
Dont le drame profond se déroule tout bas.
Toute chair emprisonne un ignoré fantôme,
Toute âme est un secret qui ne se livre pas.
Et c'est en vain, ô front ! que tu cherches l'épaule,
Refuge en qui pleurer, aimer ou confesser ;
L'être vers l'être va comme l'aimant au pôle,
Mais l'obstacle aussitôt vient entre eux se dresser.
Car, au fond de nous tous, ennemie et maîtresse,
La sphinge s'accroupit sur son dur piédestal
Et tout épanchement de coeur, toute caresse
Soudain se pétrifie à son aspect fatal.
Sa présence toujours aux nôtres se mélange,
Sa croupe désunit les corps à corps humains ;
Au fond de tous les yeux vit son regard étrange,
Ses griffes sont parmi les serrements de mains.
Et lorsque nous voulons regarder en nous-même
Pour nous y consoler et nous y reposer,
La sphinge est là, tranquille en sa froideur suprême,
L'énigme aux dents et prête à nous la proposer.
O Dame souveraine, O Vierge entre les vierges,
Pudique aux bras croisés chastement sur les seins,
Triomphante aux cheveux glorieusement ceints
vers qui montent l'encens et le frisson des cierges !
Puisque tant, les doigts joints et les genoux ployants,
Viennent pleurer leur mal aux plis de votre robe,
Moi je ne serai pas qui raille et se dérobe,
Je lèverai vers vous mes regards incroyants,
Afin de vous prier, ô refuge des âmes,
O source ! aube ! vesprée et mystère des nuits,
- Pour que Dieu veille mieux le sexe dont je suis -
D'avoir des oraisons spéciales aux femmes.
O dame ! Regardez tout ce monde si cher,
Cette féminité dont vous fîtes partie
Et voyez son enfance honteuse et pervertie
Déjà frôlée aux sens et pêchant en sa chair;
O Dame ! regardez la prime adolescence,
Les vierges aux pensers troubles, aux cils menteurs,
Chastement abaissés sur de fausses pudeurs,
Et qui savent déjà la presque jouissance;
O dame ! regardez celles qui tournent mal,
Les épouses en qui la chair ne peut se taire,
Qui trahissent sans honte et pour qui l'adultère
Finit par n'être plus qu'un passe-temps normal;
O Dame ! regardez ces reines captieuses
Qui dans leurs manteaux d'or emportent les raisons,
Les courtisanes dont absorbent les poisons
Tous ceux qu'ont pris aux nerfs leurs lèvres vicieuses;
O Dame ! Regardez au fond des lupanars
Ces rebuts de pavé dites filles de joie,
Marchandant au passant que le hasard envoie
Leur peau triste et fanée où luisent tous les fards;
O Dame ! regardez enfin ces raffinées,
Celles qui vont fuyant les baisers masculins,
Pour entre elles unir par des gestes câlins,
Leurs féminines chairs de l'homme détournées...
Regardez ! et qu'un peu de votre chasteté
Tombe de votre front étoilé de couronnes
Sur ce monde d'enfants, de femmes, de matrones
Qui vivent dans le mal et dans l'impureté !
O Dame souveraine, ô Vierge entre les vierges,
Pudique aux bras croisés chastement sur les seins,
Triomphante aux cheveux glorieusement ceints
Vers qui montent l'encens et le frisson des cierges !
La chair : pourriture vaniteuse
Qui étale de jour et de nuit
Tous ses fards et leur fraîcheur menteuse
Et sa traîne d'orgueil qui la suit.
L'Esprit : sentencieux personnage
Au doigt levé dans des thèses d'art,
Poète, musicien et sage
Rhéteur, Hamlet au profond regard.
La chair, courtisane, est à ses trousses
Et cherchant comment le faire choir
Baise ses mains de ses lèvres douces
Et le tire par son manteau noir.
Et, bien qu'austère comme un bon prêtre
Et renvoyant la gouge aux tripots
Sans vouloir l'entendre ni connaître,
L'Esprit se trouble de ces propos.
Ah ! ne plus traîner cette dépouille !
Ah ! n'être plus qu'un fantôme clair
Qui pense en paix, qui cherche et fouille
Loin des yeux mendieurs de la chair,
A travers les villes tentatrices
Et la flore des perversités
Verseuses d'essences corruptrices
Qui morphinisent les volontés !
Les voyants, par delà les générations,
Sur le couchant tragique et sur l'aube rieuse
Regardent se dresser la babel fabuleuse
Où grouillera le pas pesant des nations.
Son air a le parfum de toutes les contrées
Et ses mois le trésor de toutes les saisons,
Car il y abouti du fond des horizons
Tous les chemins du monde et toutes ses marées.
La paix y établit sa continuité
Perpétuelle afin, sous cette égide calme,
Qu'y vive le labeur terrestre - fort, pur, alme, -
Tout son vrai, tout son bien et toute sa beauté.
La science aux deux mains paisiblement utiles
Et la charité douce avec ses tendres doigts
Y soignent la misère humaine à qui la voix
Consolante de la'art dit ses chansons subtiles.
L'Idée unique offrant sa compréhension
Claire y retend les nerfs et relève les faces
Et vers Elle, de pair,marchent toutes les races,
dans leur force charnelle et leur réflexion.
Et pas un cri de faim ne sort du sein des couches
Profondes de ce peuple heureux, car les blés lourds
Ont poussé leur pain blond à même les labours
Féconds, pour l'appétit qu'ouvrent toutes les bouches,
Comme ont crû les moissons du rêve et du savoir
Au labour du génie humain, les moissons dues,
Les moissons dès alors largement répandues
A toute noble faim d'écouter et de voir.
Et cette cité s'offre au pays qui s'éloigne
Et, s'embrume sans fin d'un tardif avenir.
Mais les temps passeront et le jour doit surgir
Où cèdera sa porte au choc de quelque poigne,
Lorsque l'humanité rêveuse aura compris
Le but déjà montré du geste par les braves,
Et que les fort venus après nous, sûrs et graves,
Auront su terminer les travaux entrepris.
la mort
L'Être
Je me suis éveillé dans l'aurore naissante
Qui luit au ciel son joyau clair ;
Je me suis éveillé dans la tiédeur de l'air
Qui sans cesse refait la terre adolescente;
Je me suis éveillé dans l'aurore naissante,
dans les flocons d'avril qui fleurissent la sente
Et dans la beauté de ma chair.
Et je tends mes deux bras lyriques vers les choses,
Car mon âme, de l'aube au soir,
Pour ses torrents de vie appelle un déversoir ;
Car l'exaltation gonfle mes lèvres closes
Et je tends mes deux bras lyriques vers les choses,
Avides de brûler dans des apothéoses
Ainsi qu'un vivant encensoir.
J'ai soif de la beauté, j'ai soif de la lumière
Et de la force et de l'ampleur
Assez pour contenir l'univers dans mon coeur ;
Voulant plus que la joie humaine coutumière
J'ai soif de la beauté, j'ai soif de lalumière,
Et je vais les saisir dans l'étreinte première,
De ma belle jeunesse en fleur.
Mon âme s'ouvre à tous, profonde et fraternelle,
Ma chair s'offre à la volupté.
Ah ! que viennent l'amour, la beauté, la bonté !
Car ! pour participer à la joie éternelle,
Mon âme s'ouvre à tous profonde et fraternelle,
Var je sens palpiter comme un aigle son aile
L'espoir dont mon être est hanté !
Le premier spectre.
Je suis là.
Le second spectre.
Je suis là.
L'Etre.
Quelles sont ces deux ombres ?
Elles s'assoient ainsi que deux visiteurs sombres
Et muets, toutes deux à ma porte. l'une a,
A même la figure, un masque d'incarnat
Et qui rit ; et sa robe est d'étoffe fleurie ;
Une couronne prise à travers champs marie
Le vif de des couleurs au noir de ses cheveux.
Et l'autre a répandu sus ses membres nerveux
Une étoffe de lin imiteuse de lange,
Pendant que rien ne luit sur son visage étrange
Qui n'a ni yeux, ni nez, ni bouche, que ses dents ;
Elle semble cacher dans ses drapés prudents
Quelque arme à tranchant clair dont je ne me rends compte.
Le premier spectre.
Nous sommes là tous deux pour te conter un conte,
Mais, avant que nos voix te parlent tour à tour,
Lève la belle robe où se fond mon contour,
Fleure les belles fleurs dont ma tête se noue,
Ecarte le beau masque appliqué sur ma joue
Et, sous ma robe, vois mes blessures saigner,
Tous mes calices frais prêts à t'empoisonner
Et son mon masque gai sangloter ma figure.
Je suis la Vie.
Le second spectre.
Et moi, soulève ma vêture
Pauvre qui ferait croire un corps sous ses plis faux ;
Tu n'y vois qu'un squelette étriqué ; mais la faulx
Que j'y cachais t'éclate aux yeux, arme qui reste
Terriblement rivée au hasard de mon geste.
Je suis la Mort.
L'Etre.
O couple affreux ! Spectres jumeaux !
Quelle histoire d'horreur va sortir de vos mots !
Le premier spectre.
Vois ! Des cortèges vont sans but ; ah les cortèges,
Les mornes, les pareils toujours !
Par villes et par champs, par les nuits, par les jours,
Par les printemps et par les neiges !
Vois ! Ce sont des bras fous tragiquement tordus
Et des bouches d'où le cri monte,
Cri de révolte et cri de deuil, misère et honte,
Désirs et doutes éperdus.
Vois ! la faim râle au fond des taudis, et le vice
Emplit bouges et lupanars,
Et la maladie âpre aux milles cauchemars
Grouille et déborde de l'hospice ;
Vois ! les adieux, l'orgueil à bas, l'amour trahi
Hurlent, poussés vers les suicides,
vers le plaisir tueur de mémoires lucides,
Vers l'alcool recéleur d'oubli ;
Les refuges cherchés gardent leurs portes closes,
L'amour est un leurre et l'art ment,
La musique et les vers sont un nouveau tourment
Où resanglotent les névroses,
Et l'Idéal, idole au geste solennel,
Debout et le chef dans les nues,
Répond aux piétés des foules accourues
Par un "à quoi bon ? " éternel !
L'Etre
Au secours ! Au secours !...
Le Spectre
Ecoute la sentence
Epouvantable jusqu'au bout :
Tu resteras toujours vivant, toujours debout
Malgré l'enfer de l'existence,
Marqué tout à la fois dans ta chair et ton coeur
Par la grande misère humaine,
Rides du lourd péché, de l'espérance vaine
Et de l'inutile labeur,
Et, flagellé, rempli d'horreur et d'anémie,
Dans le silence et l'abandon,
Sombre, tu couveras une haine sans nom
Pour ton ambiance ennemie !
Et maintenant, adieu! vers l'avenir maudit
Dont l'effroi déjà te trépane,
Déambule, pantin ! navigue, barque en panne !
Pour moi, je me rassieds. J'ai dit !
L'Etre.
O bonne mort ! ô mort douce et pleine de grâce,
C'est vers toi, dans l'horreur folle qui me terrasse
Qu, les yeux ruisselants de trop d'affliction,
Je tends mes bras chercheurs de consolation,
Eternelle présence à qui mon pas se rive,
Seul but où diriger mon atroce dérive,
O toi l'unique, ô toi l'immanquable, la soeur,
prends-moi comme un enfant qui pleure sur ton coeur
Et conte-moi tout bas la croyance future ;
Car rien n'a pu dans toute la nature
Assouvir le désir dont j'étais dévoré,
Puisque je reste en deuil de mon espoir doré
Puisque pour cette soif dont mon âme déssèche
Je n'ai pu nulle part trouver de source fraîche,
A moi l'espoir qui fait renaître les coeurs morts !
A moi la bonne paix hanteuse d'âmes veuves !
A moi le baume en qui les esprits et les corps
Se guérissent du mal profond de trop d'épreuves!
A moi la joie après la mort, remplacement
Du bonheur que cherchait mon âme printanière,
Seule source où pourra boire éternellement
Mon éternelle soif de Vie et de Lumière !
Ah ! puisqu'il FAUT connaître ici-bas la douleur,
Puisque la loi fatale est pour nous tous la même,
Donne-moi la douleur où l'on met tous son coeur,
Donne-moi la douleur au fond de qui l'on aime :
Fais que mon désespoir se fonde en pitié,
Fais qu'âme et chair je sois une double victime
D'un holocauste fait à la Divinité
Grand d'être volontaire, énergique, anonyme ;
Que je serve d'enclume à ce divin marteau,
Que mon infimité se grandisse et rehausse
D'obéir tout entière à l'Infini, plutôt
Qu'à cette vanité terrestre, inepte et fausse,
Et parmi le chagrin, la souffrance et l'ennui,
Dans ce cortège humain qui languit et qui pleure,
S'il faut vivre, je vis ! Mais que ce soit pour lui,
Dieu ! Dieu, mon seul espoir, mon but et ma demeure !
Le second spectre.
Clame ton impuissance ou prie humble et tout bas,
Le muet Infini ne te répondra pas.
Le suprême dédain de cette offre sublime
De sacrifice auguste, austère, entier, INTIME,
Tombe, avec ce silence implacable, sur toi.
Il n'y a ni l'espoir, ni le but, ni le toit
Derrière le secret de la voûte infinie.
Pour moi, je t'apprendrai la peur de l'agonie,
Le remords de la fin, la terreur de l'après,
Toutes ces affres qui, soit de loin, soit de près
Te guettent, puisqu'il faut que tout être succombe ;
Je t'apprendrai l'horreur de l'oubli sur ta tombe,
Seconde mort à qui nul n'échappe ici-bas.
Mais, où ton âme ira, tu ne le sauras pas.
Que le monde sur toi laisse tomber sa porte,
Je ne te dirai pas les lieux où je t'emporte.
Maintenant, tends au ciel ton bras désespéré ;
Cherches-y le prétexte et la raison ; muré,
Lève sur cet espace ouvert ton oeil avide,
Et tu n'y verras rien qu'un formidable vide,
Cependant qu'à tes pieds monte le mauvais bruit
Du monde qu'à présent toute ton âme est fuit,
Hideux de sa douleur et de sa gaîté pire
Comme un sanglot noyé dans un éclat de rire !
L'Etre.
L'horreur de ton discours est plus profonde encor...
Au secours ! Au secours !... Ah la vie et la mort !...
Ah ! spectres !... Où vous fuir ? Où cacher ma détresse,
O vide en qui ma tête impuissante se dresse ?...
Rien !... Rien... nuit, solitude et silence... O mon coeur,
Quelle épouvante!... Où fuir ?... J'ai peur! J'ai peur!
Paroles
II
Mon génie est en moi, profond et solitaire,
Emplissant ma journée et ma veille nocturne
Comme une flamme dont, vestale taciturne,
J'attise le foyer dans l'ombre et le mystère.
Il est le dieu jaloux, le gardien soucieux
Qui me dit dans mes maux qu'il ne faut pas mourir,
Dans mes tentations qu'il ne faut pas faillir
Et dans mes vanités qu'il faut le servir mieux.
Il est le dieu plus grand et plus beau que moi-même
Dont mon coeur est l'autel, dont mon corps est le templs ;
Mon être, trop étroit pour ce souffle trop ample,
Est las de contenir sa présence suprême.
C'est un dieu qu'on ignore et qui me survivra
Peut-être, ainsi qu'à toi, foule où s'en vont mes pas,
O foule d'aujourd'hui qui ne me connais pas,
Grande brute à qui nul alors de pensera !
Calmes élues au front de qui la gloire noue
Sous les regards publics ses lauriers honoraires,
Parmi l'encens banal de vos thuriféraires,
Etalez votre orgueil comme le paon sa roue !
Moi, je suis la passante inconnue aux pieds lents
Qui marche dans la foule en agitation,
Hautaine et sans désir de sa laudation
Qui fait tant de coeurs battre et haleter de flancs.
Ma Muse m'a prêté son envergure d'ange
Et je sens frissonner mes épaules femme
Pour des envols si hauts qu'ils emportent mon âme
A jamais loin du monde où clame la louange ;
Ma Muse a mis en moi quelque chose de plus
Que des chansons d'enfant ou des soupirs éclos
Pour l'hommage de ceux qui, rires ou sanglots,
Bercent tout de pareils hosannas superflus.
Ma Muse a mis en moi la plainte inassouvie
D'une amante qui veut un dieu pour son étreinte,
Qui pour sa passion folle et jamais éteinte
Cherche plus que l'amour humain et que la vie,
Le cri d'horreur, le cri mental, le cri charnel
D'une qui hait la terre et, furieusement,
Menant son coeur lassé vers l'impossible Aimant,
Pleure, les bras tordus par le doute éternel.
*
Pourquoi, toi qui viens au miroir à ma rencontre,
Qui te revêts de noir comme d'un deuil d'ennui,
Pourquoi, triste avec tes grands yeux remplis de nuit
Et ta bouche enfantine trop bien close,
Sans rire adolescent qui pouffe malgré lui,
Pourquoi, triste avec tes grands yeux remplis de nuit
venir à moi muette et le front si morose ?
Si jeune !... Te faut-il pour consoler ton mal
Un bouquet ? Un bijou d'enfant qui te décore ?
Si jeune !... Te faut-il pour consoler ton mal
Un jeu, toi que le jeu doit faire rire encore,
Que, presque, bercerait le geste maternel,
Qui ne dois pas savoir, bouche en fleur, yeux d'aurore ?
Un bouquet, un bijou d'enfant qui te décore,
Est-ce là ce qu'il faut à ce deuil solennel ?
... Ah! dis-le que ta bouche est fleur empoisonnée
Pour avoir déjà ri gouaille et cruauté ;
Ah! dis-le que ta bouche est fleur empoisonnée !
Toi qu'on juge espérance et puérilité,
Dis-le que tes grands yeux étonnés ne s'étonnent
Plus de rien pour avoir trop vu l'humanité ;
Toi qu'on juge espérance et puérilité,
Dis, dis, dis tes mains dans le noir qui tâtonnent!
Dis que ton deuil est deuil de tout ce qui n'est plus,
Espoir, illusion, candeur, charme de vivre.
Dis que ce deuil est deuil de tout ce qui n'est plus !
Toujours en mains, jamais fermé, toujours ce livre,
Dis qu'il est un dernier asile au coeur très vieux
Attendant en lisant que la mort le délivre,
Toujours en mains, jamais fermé, toujours ce livre
Où se penche ton front lourd de jeunes cheveux !
Si vous aimez encore une petite âme
Que vous avez eue en mains au temps passé,
Qui n'était alors qu'une embryon de femme
Mais dont le regard était déjà lassé,
Si vous aimez encore une petite âme,
Laissez-la quelquefois revenir encor
A vous, que charmaient ses yeux mélancoliques.
Vous vouliez, songeant déjà sa bonne mort
La refaçonner dans vos doigts catholiques,
Laissez-là quelquefois revenir encor.
Elle n'est pas devenue une chrétienne,
Elle est même à présent, comme qui dirait,
Sans foi, ni loi, ni joie, une âme païenne
Des temps de décadence où tout s'effondrait.
Elle n'est pas devenue une chrétienne.
Sa fantaisie a la bride sur le cou.
C'est un bel hippogriffe qu'elle chevauche,
Qui de terre en ciel la promène partout
Sans plus s'arrêter au bien qu'à la débauche.
Sa fantaisie a la bride sur le cou.
Elle a l'oeil triste et la bouche taciturne
Et quoique parfois ses essors soient très beaux,
Comme elle a bu le temps présent à pleine urne,
Elle se meurt de spleen, lambeaux par lambeaux.
Elle a l'oeil triste et la bouche taciturne.
Son dos jeune a le poids du siècle à porter
Comme une mauvaise croix, sans coeur d'apôtre
Et sans assomption future à monter.
Voilà ce qu'elle est devenue et rien d'autre.
Son dos jeune a le poids du siècle à porter.
Mais le souvenir parmi d'autres lui reste
De vos mains qui la soignaient comme une fleur ;
Et si vous vouliez lui rendre votre geste,
Elle pleurerait son mal sur votre coeur,
Car le souvenir parmi d'autres lui reste.
Lassez-la quelquefois revenir encor
A vous que charmaient ses yeux mélancoliques.
Vous vouliez, songeant déjà sa bonne mort
La refaçonner dans vos doigts catholiques,
Laissez-la quelquefois revenir encor.
Des midis d'ombre et d'or aux crépuscules roses,
De la gaieté de l'aube à l'horreur de la nuit,
Au cours des jours passés où traîna mon ennui,
J'ai donné mon coeur vierge à la beauté des choses.
J'ai crié mon amour aux paysages fous,
Au vent paroxysmal, aux fureurs des marées,
Et je l'ai dit tout bas aux placides soirées
Dont la sérénité fait plier les genoux.
Mon coeur s'est répandu sur la splendeur des villes,
Mon coeur s'est répandu sur les livres ouverts ;
Les sciences, les arts, la musique, les vers
L'ont pris et l'ont repris dans leurs trames subtiles ;
Des voix l'ont pris ; il s'est noyé parmi les eaux
Troublantes qui stagnaient en d'étranges prunelles,
Et le contour du marbre ou des lignes charnelles
Et l'âme des parfums l'ont eu dans leurs réseaux.
Si tu le veux, mon coeur, cherche-le parmi l'oeuvre
Multiple que créa sur terre la Beauté,
Dans sa toute-puissance et sa subtilité,
Et qui par mille bras me tient comme une pieuvre...
Ou plutôt, si tu veux ce coeur toujours fermé,
Au lieu de le chercher parmi tout ce que j'aime,
Toi que je n'aime pas, sois la Beauté toi-même,
Sois le dieu ! tu seras aussi le bien-aimé.
Le désir des amants hante le solitudes
Où se complaît ton rêve impossible et hautain,
Avide de capter ainsi qu'un aigle atteint
Ton grand coeur désailé tombé des altitudes.
Dans ta grâce rythmique et dans ta volupté
Ils détestent la route isolée où tu rôdes
sans que tiennent leurs doigts tes mains ùates et chaudes,
Sans que fasse leur force escorte à la beauté.
Ils regrettent ta joue offerte toute nue
Comme une pêche ronde où rosit le duvet,
cette bouche d'enfant dont leur baiser rêvait
Et qui ne leur tend point sa belle fleur charnue.
Il regrettent tes yeux qui brûlent le regard
Loin d'eux sous l'écrin lourd de tes paupières moites,
Ton geste absent du leur, tes inflexions coites
Et tes poses vivant leur souplesse à l'écart...
Ah ! pourquoi ta fraîcheur, puisque tu te dérobes
Dans ta haute pensée et ton mal soucieux,
Et pourquoi, sur ce coeur sombre et sentencieux,
Ces seins vivants claustrés aux plis prudes des robes ?
Pourquoi ces cheveux fous où tout l'automne dort,
Ces bras tièdes berceurs de tendresses nocturnes,
Ces hanches où revit la courbe ample des urnes,
Tant de jeunesse prête à l'amour jeune et fort,
Puisque, te reniant en ta chair tentatrice,
Le mépris de la vie humaine et de sa loi
Te fait vivre déjà comme un fantôme froid
Avant que n'ait sonné l'heure libératrice ?
Je donne ce qui reste en moi grave et pudique
Malgré tout mon péché de pensée et de chair,
Le coeur pieux, le coeur chaste et mélancolique
Qui prie à travers ma gouaille au rire amer,
Je donne ce coeur-là, cette chair-là, ces choses
Dont j'ai fait en moi un spécial encensoir
A toute la mer, à tous les couchants, aux roses,
Aux clairs de lune bleus dont ruisselle le soir,
A toutes ces splendeurs vivantes de la terre
En qui pâme de joie mon âme solitaire.
Les amants sont venus à moi pour m'adorer
Et j'ai cru que chacun allait être mon rêve
Et que j'allais enfin connaître l'heure brève
Où vibrer tout entière et prier et pleurer.
Mais, hélas ! les amants n'ont pas compris mon âme
Et j'ai vu choir tous leurs prestiges tour à tour.
Ils n'ont pas su m'aimer, ils n'ont pas su l'amour,
Ils n'ont pas su l'amante, ils n'ont pas su la femme.
Et je les ai punis de n'avoir pas compris :
J'ai détourné loin d'eux ma bouche et mes caresses,
Je les ai déchirés dans mes mains vengeresses,
Je les ai chassés tous, sanglants et plus épris.
Et je veux demeurer de chair et d'âme vierge ;
Et les amants viendront à moi pour m'adorer ;
Mais implacablement je les ferai pleurer
Et s'en aller, vaincus, de ma hautaine berge.
Mon temps, mon temps, pourquoi
Ai-je absorbé ton âme immense jusqu'aux moelles
Avec toute sa boue et toutes ses étoiles ?
Je souffre dans mes sens
Où croît avec le lys de mon plus chaste songe
Une fleur de mauvais désir et de mensonge ;
En l'âpre cruauté
Qui rugit dans mon coeur comme un tigre des jungles
Pendant que ma pitié hait le sang demes ongles ;
En l'égoïsme fou
Qui fait indifférents tous les maux hors ma peine
Quand ruissellent mes yeux sur la misère humaine ;
En le lâche abandon
Qui me fait par la vie indécise et flottante
Alors que mon sang bout d'audacemilitante ;
J'ai peur de moi, j'ai peur
Que LES AUTRES ne voient vivre en mon regard trouble
Le disparate affreux de ma nature double,
Et je veux recouvrir
Le drame insoupçonné de cette horreur intime
D'hupocrisie ainsi que d'un masque de mime,
Pour qu'ils ignorent tous
Si mon coeur vrai sanglote ou rit sous la grimace
Factice qui toujours me cachera la face,
Car je redoute autant,
Tous deux devant blesser quelque chose en mon âme,
Le regard qui m'approuve et celui qui me blâme.
Qui me donnerait l'abrutissement ?
Je rêve des coussins de mollesse où s'étale,
fardée aux quatre coins, la chair orientale ;
Je suis de l'oeil, les poings aux hanches, gorge lâche,
Gros rire, une gothon qui va traire sa vache ;
Voici le pot qui bout, le timbre qui dégoise,
Une province, une cuisine, une bourgeoise ;
Voici, dans la tiédeur d'une intimité fine,
La dolente qu'endort sa morbide morphine ;
Voici les fronts blafards forgés aux mêmes moules,`
Lourds de discours pâteux aux dents des femmes saoules ;
Voici le geste en croix, la faim qui débilite,
Le silence, l'orante en deuil, la carmélite ;
Voici l'amante aussi, déchirée et têtue,
Qui s'agrippe à l'amour disparu qui la tue...
Ah qui me donnera l'abrutissment,
Qui me donnera l'abrutissment ?
A ma soeur Georgina
Je demeurerai tête basse et doigts joints
A te recueillir en mon coeur solitaire
Et qui souffre et qui se meurt du terre à terre,
O toi par qui les fronts se sentent comme oints,
Béatifiante musique chrétienne
Mariée aux rouges et bleus des vitraux
Et qui fais revivre en tes bas et hauts
La si séculaire âme grégorienne.
Ton charme hypnotique endort au fond de nous
Ce qui s'y hérisse en chagrin, vice ou haine,
Comme un mauvais Saül sous la harpe amène
Et fait tomber notre orgueil à deux genoux.
Et nous oublions tout ce qui nous attaque
Et notre fatigante lutte en champ clos
Et nos secrets et nos peurs et nos sanglots
Au rythme de ta voix paradisiaque...
Ah ! viens me faire croire à l'éternité !
Pénètre jusqu'à ce coeur par cette ouïe
Pour lui verser, ô toi ! source de Samarie,
Un peu de ta fraîcheur et de ta pureté !
*
Grand ange désailé qui rôdes dans la vie,
Ame, mon âme !
Violon sans archet, triste barque sans rame,
Ame, ô mon âme inassouvie !
Toi qui voudrais aller autre part qu'où te mène
Mon impuissante chair humaine,
O mon âme, âme trouble, âme en peine,
Fardeau trop lourd comment te laisser en arrière
Puisque la route est longue à suivre?
Comment t'assassiner, monstrueuse chimère,
Puisque tu m'empêches de vivre ?...
Resquiescat sur toi, mon enfance morte.
Je t'ai couverte de mes pleurs
Et de mes fleurs
Comme fait au petit que la fièvre emporte
Quelque mère au coeur percé des sept douleurs.
Repose en paix, ô petite silhouette
Mourante avec seuls deux grands yeux
Très malheureux
Ouverts dans ta pâleur candide et fluette
Pour qui tout était terrible ou merveilleux.
Petite âme ,e comprenant rien aux choses,
Voyant la vie ainsi qu'un vrai conte bleu,
Simplette un peu,
Faible de son enfance et de ses chloroses,
Mais couvant déjà ses songes comme un feu,
Ouvrant ces deux grands iris visionnaires
Sur des rêves si fous, si beaux d'ombre et d'or
Dans un tel décor !
Puis jamais du goût de ces pensionnaires
Godiches, mais naïve, humble plus encor.
Petite âme se sentant comme à la gêne
Avec déjà, ô mes peurs ! de la terreu,
Sans âme soeur,
En défiance d'on ne sait quelle haine,
Avec surtout cette terreur pleiin le coeur...
Requiescat sur toi, petit mausolée
Que j'élève aujourd'hui dans mon coeur lassé
In pace !
Puissé-je sur ma jeunesse désolée,
Un jour, en bâtir un pur comme ce passé !
L'âme des rues
A Mlle Marie Bengesco.
I
J'aime que sur la place où traîne le couchant
Monte, parmi le bruit des foules, le doux chant
Des eaux claires sonnant au bronze des fontaines
Et que, centre au rempart des églises hautaines,
Dont le fleuve en passant fait ruisseler le seuil,
Et des lourds monuments des des arches d'orgueil,
L'obélisque fluet s'érige sous l'égide
Des huit villes siégeant dans leur robe rigide,
Qui, sur le crépuscule où meurent les contours,
Profilent en vigueur leurs chefs couronnés de tours ;
Et qu'auprès, scintillant comme un ballet d'étoiles,
Tournoie en titubant, névrosé jusqu'aux moelles,
Génial, amer, gai, charmant, terrible, gris,
Le grand léviathan écaillé d'or, Paris !
II
L'ample courbe des arcs de triomphe angulauex
Dont les ornements durs crèvent le ciel houleux,
Encadre le couchant qui monte et qui flamboie
Au loin comme un énorme et muet feu de joie,
Fond pur où les troncs noirs détachent leurs profils
Avec tous leurs rameaux fluets comme des fils,
Atmosphère dorée où s'élancent les flèches
Des clochers et que boit la pierre à pleines brèches,
Où les carreaux de vitre et la clarté des eaux
Redisent la splendeur du ciel, où les oiseaux
Laissent, portant aux nids leur butin minuscule,
Au travers de leur vol passer le crépuscule...
O pureté des cieux ! ô silence ! ô douceur !
Immense calme où peut se retremper le coeur,
Mourir la chair, l'esprit revenir à la règle
Et l'âme déployer son envergure d'aigle !
Je t'ai dans mes regards, la ville ! ample grisaille
Que j'ai vue, accoudée aux ponts monumentaux,
Les soirs que mon coeur las de n'être rien qui vaille
Pesait tant vers l'horreur tentatrice des eaux.
Mes iris sont encor large ouverts sur ton fleuve
Qui noyait, renversés, trop d'édifices lourds,
Où, fantôme ambigu traînant des deuils de veuve,
Je me savais passer lentement à rebours,
Parmi tes tours d'orgueil et tes arches famées,
Alors que le couchant éclos comme un matin
Ne flambait plus le ciel factice des fumées,
Calmé dans les douceurs d'un crépuscule éteint ;
Alors qu'en gouttes d'or tombant une par une,
Dardant la vie étrange et sourde des reflets,
De toutes ses lueurs pleurait ta masse brune
A même l'eau profonde et ses remous muets
Et qu'en étirements de lumière mouillée,
Grouillement d'astres morts tristement submergés,
Flore d'algues de feu fictive et détaillée,
Spirales de phosphore aux rythmes dérangés,
Ainsi cette harmonie animale et qui bouge
Luisait et redoublait lorsque, crevant les eaux,
Traînant leur chevelure en flamme, verte et rouge,
Dans un flot de clartés s'avançaient des bateaux.
Le ciel gris au vent court s'effilocher
A la pointe des clochers.
les arbres transis font leur triste roue
Sur les trottoirs gras de boue.
Que le mauvais temps pèse lourd aux coeurs
Qui promènent des rancoeurs !
Oh ! marcher sans but ! Oh ! marcher quand houle
L'hiver terne sur la foule,
Seul, bâillant sa peine aux nuages fous
Qui s'en vont on ne sait où !...
Lorsque, brume d'hiver, ô brume qui t'étales
Sur la ville et ses silhouettes colossales,
La vie en toi est un fantôme qui s'enfuit,
Que perdent les clochers leur pointe dans ta nuit
Où, sans pourpre, un couchant invisible défaille,
Sur le fleuve apparaît, joyau de ta grisaille,
La lanterne subite, unique d'un bateau,
Laquelle, entre le ciel triste et l'horreur de l'eau,
Tout à coup pique aux yeux son étrange point rouge
Qui bouge.
Pour qu'encore la Ville offre le divin Coeur
En expiation de son immense faute,
Haut de sa place et haut d'architecture haute,
Comme un défi de pierre au blasphème moqueur,
Montmartre dresse au ciel son profil catholique...
Noyé déjà du gris des évocations
Pour avoir exhaussé son désir ironique
De monter sur ce siècle-ci ses factions ;
Cerné d'humanité qui se plie et se replie,
Montmartre ! et son "sursum corda" perpétuel,
Que contredit l'horreur de la rue en folie,
Montmartre ! encens et carillons ! Ce rituel
Au coeur des carrefours que la ville échelonne !
Montmartre... Cet espoir sur cette Babylone !
Le givre sculpte, issu de l'arrière-saison,
Les arbres du trottoir grêles de frondaison
Effeuillée.
Dans la brume, un flonflon mille fois répété
D'orgue de Barbarie, égrène sa gaieté
Eraillée.
Oh ! le geste tremblant de froid et dont, sans fin,
L'être caché qui joue ainsi berce la faim
Qui le serre !
Voix dans la brume, voix que l'on n'écoute pas,
Dans laquelle sanglote en quadrilles, là-bas,
La misère.
Le Mardi gras, falot comme un fantoche,
Met son faux-nez à l'huis, fait briller ses galons,
Siffle un air, et chacun, sautant sur ses talons,
Bâille et s'éveille avec une âme de gavroche.
Enflons de confetti quelque énorme sacoche ;
Le labeur de demain paiera les violons ;
Pendant trois jours entiers, vive la vie ! allons
Déambuler avec la bonne humeur en poche !
Les masques ont au bras les dominos fleuris
Et, sur l'arquelinade immense qu'est Paris,
Une neige en papier tombe, multicolore.
Cependant qu'imitant quelque souffle estival
Les serpentins fluets, comme une étrange flore,
Font aux arbres d'hiver flotter le carnaval.
Visages où reluit l'oeil assommé de noir
Dans le blême du fard piqué de fausses mouches
Et que barre le rouge exaspéré des bouches,
Elles traînent à deux dans l'ombre d'un trottoir.
Elles vont avec un canaille nonchaloir
Et le parler trop près des intimités louches ;
Et des plumes de coq, silhouettes farouches,
Sur leurs chapeaux baissés tremblent au vent du soir.
Et, cependant qu'au loin ces figures de vice
Bras dessus, bras dessous, font l'agent de service
Cligner un regard dur sous un sourcil matois,
Une procession d'étoiles, aux cieux vastes
S'égrène par delà l'océan fou des toites
Pour les rêves émus et les prunelles chastes...
Le fantôme de notre désir
A noyé dans les eaux fluviales
Combien de fois ! son corps sans plaisir,
Son coeur gros de peines capitales,
Las de les compter et ressasser,
Sa tête lourde de trop penser ?
Que de cadavres imaginaires
Flottent entre les quais surchargés
En qui nous nous voyons, submergés,
Dormir le repos à deux paupières
D'un front libre de ton poids ôté,
Fatigante personnalité !
J'ai regardé la ville au loin de tous mes yeux,
Lourde de dômes ronds, lourde d'arcs orgueilleux,
Légère de son trop de flèches,
Crever le couchant rouge avec ses pointes sèches.
De la pierre !... Le fleuve en passant sous les ponts
Redisait cette pierre en ses fonds et tréfonds,
Ah ! de la pierre, ah ! de la pierre !
Toute la pierre, étau géant et tumulaire,
Tombale ville, étau des rêves qui s'enfuient
Dans les couchants avec les regards qui s'ennuient
Des enfances mélancoliques,
Songeant des jardins verts sous des ciels bucoliques !...
Rondels
A ma mère.
Le vent balance les ombelles
En de petits saluts exquis.
Blanches comme autant de marquis,
Elles meuvent leurs ribambelles.
Un bourdon, sur chacune d'elles,
Se prélasse en pays conquis.
Le vent balance les ombelles
En de petits saluts exquis.
Avec un doux battement d'ailes,
Pour visiter leur fin marquis,
Les papillon bleus sont requis
Toutes rondes et toutes belles,
Le vent balance les ombelles.
Avec leurs pinces en avant,
Trois crabes sortent d'une flaque.
La vase luit comme une laque
Dans l'éclat rose du Levant.
Un gros galet fit paravent
Sous le goémon qui le plaque ;
Avec leurs pinces en avant,
Trois crabes sortent d'une flaque.
Et, tachant de sable mouvant
Leur carapace âpre qui claque,
Ils vont vers un autre cloaque,
Humides, boueux et rêvant
Avec leurs pinces en avant.
Chacun renaît au crépuscule,
L'aile terne et le ventre roux ;
Et, dans le vent qui les bouscule,
Ils sortent sans bruit des vieux trous.
Leur quadrille va, vient, recule,
S'accroche à la haie en courroux.
Chacun renaît au crépuscule,
L'aile terne et le ventre roux ;
Et, lorsque le soleil bascule
Et meurt derrière les grands houx,
Lourd, à l'heure des loups-garous,
Comme un revenant minuscule,
Chacun renaît au crépuscule.
Aussi gentil qu'un bibelot,
Le cochon d'Inde erre et trottine,
Entre un vieux débris de tartine
Et quatre épluchures pour lot.
On le décore d'un grelot,
Un revers de main le satine ;
Aussi gentil qu'un bibelot,
Le cochon d'Inde erre et trottine.
On rit de son menu galop
Et de voir, lorsqu'il se mutine,
Son oeil en bouton de bottine
Luire dans son minois falot,
Aussi gentil qu'un bibelot.
Les petits souliers longs d'un pouce,
Pleins de joujoux, rangés en rond,
Bâillent dans l'âtre où se trémousse
Le criquet au menu ronron.
Oh ! la curieuse frimousse
Des bébés qui découvriront
Les petits souliers longs d'un pouce
Pleins de joujoux, rangés en rond!
Pour ceux que le temps chasse et pousse,
Les noëls aussi reviendront ;
Mais jamais plus ne chausseront
- Le coeur baigné de candeur douce -
Les petits souliers longs d'un pouce...
Quand Minuit lentement tocsine,
les hiboux, ouvrant leurs yeux ronds,
S'élancent du sein des vieux troncs
Vers la lune qui les fascine.
Avec leur sanglot qui lancine
Ils nous rendraient presque poltrons,
Quand Minuit lentement tocsine
Les hiboux ouvrant leurs yeux ronds !
Mais aux heures où se dessine
Un rêve de mort sous les fronts,
Qu'on aime entendre aux environs
ce cri d'enfant qu'on assassine,
Quand Minuit lentement tocsine !
Les bourdons meurent dans les fleurs
Aux mignonnes architectures !
Pour jusqu'aux époques futures
Où les raniment les chaleurs.
Oh ! combien ces petits voleurs
Eurent sur elles d'aventures !
Les bourdons meurent dans les fleurs
Aux mignonnes architectures.
Et voici que les vents frôleurs
Bercent ces frêles sépultures
Et que, glissant aux ouvertures,
La rosée y vers des pleurs...
Les bourdons meurent dans les fleurs.
La pendule bat comme un coeur
Dans son armature de cuivre,
Seul bruit le soir quand je me livre
Au travail, du somme vainqueur.
Vers de joie ou vers de rancoeur,
Rythmant la strophe qui m'enivre,
La pendule bat comme un coeur
Dans son armature de cuivre.
Et, tandis que viennent en choeur
Les souris grises se poursuivre
Et danser autour de mon livre
Leur ballet muet et moqueur,
La pendule bat comme un coeur.
Les chansons d'autrefois, mineures ou gentilles,
Longuement, tristement, chantent près des berceaux
Ouatés et tout ronds comme des nids d'oiseaux,
Pour les petits garçons et les petites filles.
Voix rauque de l'aïeule où tremblotent les trilles,
Voix pure de la mère où jasent des ruisseaux,
Les chansons d'autrefois, mineures ou gentilles,
Longuement, tristement, chantent près des berceaux.
Sous les doigts patients, sous les lentes chevilles
Qui les meuvent ainsi que le flot ses vaisseaux,
Ils dorment, ignorant la vie et ses assauts,
Les petits pour qui sont - dorures ou guenilles -
Les chansons d'autrefois mineures ou gentilles.
L'encensoir
O belle ! je voudrais comme quelque Athéné
Te voir surgir du fond de mes rimes guerrières,
Tout l'être d'un atour héroïque adorné.
Car il siérait fort bien à tes grandes manières,
A ce port belliqueux que fuient les nonchaloirs
De vêtir l'appareil des époques premières ;
Car nul chef, redressé pour de rudes vouloirs,
Ne te vaudrait coiffant du casque des batailles
Le casque ténébreux de tes longs cheveux noirs ;
Car ton torse vivrait à l'aise dans les mailles
De la cotte moulant la gloire de tes seins
Parmi le chatoiement poissonneux des écailles ;
Car ton col est de ceux qui pourraient être ceints
Par le quadruple tour des colliers de Palmyre
Que, sans ployer, portait la reine aux grands desseins ;
Car enfin, comme au temps que notre rêve admire,
Au front de quelque horde on te voit aisément
Etinceler ainsi qu'un vivant point de mire.
Ah ! pendant qu'attiré comme par un aimant
Mon regard obstiné te suit et te contemple,
Laisse mon fol esprit s'abuser un moment !
Laisse-moi remplir l'air avec ton appel ample
Menant tes escadrons aux sauvages refrains
Vers la destruction de la ville et du temple ;
Laisse-moi, cependant que se cambrent tes reins
Mêler le cliquetis de tes armes brandies
Au choc des joyaux lourds sortis de tes écrins ;
J'allume tes yeux noirs au feu des incendies,
J'étale la blancheur féroce de tes dents
Dans un rire annonçant de proches tragédies,
je mets derrière toi des horizons ardents,
Devant toi le butin qu'indique ton grand geste
A qui répond le choeur de mille cris stridents,
Pour, parmi ce décor fictif de plaine agreste
Que foulent au galop les pieds des étalons
A la suite desquels nulle moisson ne reste,
Terrible, frémissant de la nuque aux talons,
La poigne exaspérée au manche de l'épée,
La course déployant au vent tes cheveux longs,
Animer de toi seule une immense épopée !
Ce marbre dormait, brut, depuis l'antiquité
Et les temps étaient loin des dieux et des érèbes,
Qu'il attendait encore, enfoui dans les glèbes,
Qu'un maître en fît jaillir quelque divinité.
Et les siècles, passant sur lui, l'ont respecté
Afin qu'un jour, livrée à l'amour des éphèbes,
Des mûrs et des vieillards et dominant les plèbes,
L'art y pétrifiât pour toujours ta beauté.
Et le temps qui détruit la splendeur des visages
Peut, sur ton effigie, entasser tous ses âges :
De même que la gloire au socle des héros
L'hommage ira toujours, ainsi qu'une corolle
Fleurir et caresser cette chair de Paros
Où demeure à jamais ton sourire d'idole.
Magistrale Sarah, tu passes et repasses
Sous nos regards ainsi qu'un paon
Que suit, en imitant les écrins et les châsses,
La traîne énorme qu'il répand.
Et ta chère personne en notre esprit perplexe
Jette trouble et charme à la fois,
Car nous y percevons cette essence complexe
Que met en musique ta voix,
Laquelle fait rêver reliquaire et musée,
La Madone et Sammouramit,
L'idole égyptienne et l'affiche irisée
Où tant l'art moderne te mit,
Qui mêle la classique à l'actuelle idée,
Qui fait en toi s'épanouir
La symétrique acanthe et la folle orchidée
Et le tout pour nous éblouir.
Muse, hétaïre, reine, amante, sphinge, guivre
Vers qui vont les désirs humains ;
Féminine présence en qui viennent revivre
Tous les cortèges féminins ;
Réincarnation des époques finies,
Spectre de celles qui seront,
Aube et couchant, espoirs et pâles agonies,
Clartés et tristesses du front,
O Sarah ! dont la voix a le timbre des lyres,
En toi, prestige de nos yeux,
Nous voyons et touchons tout ce qu'en ses délires
Notre songe inventa de mieux.
Car Sarah c'est vraiment un monde qui palpite,
Tout un monde de rêve et d'art
Dont l'âme, vérité toujours unie au mythe,
Vit au gouffre de son regard ;
Sarah, c'est celle dont, sans fin, le geste sème
De frais calices ignorés
Et rythme, Son, Couleur, de son style suprême
Naissent tels que des lys dorés,
De ce style sorti de ses cordes profondes,
Qui vit jusqu'au bout de ses doigts,
Qui marche dans son pas, flambe à ses boucles blondes
Et tremble aux notes de sa voix ;
De ce style imposant ses rituels étranges
Du vêtement jusqu'au décor,
Réglant tout, le parfum, les bagues des phalanges,
Le fard, l'ampleur des colliers d'or.
Sarah, c'est celle qui, dans une vie unique,
En vécut dix en même temps,
Comme si la jeunesse aux plis de sa tunique
Ramenait toujours le printemps ;
C'est celle qui sut prendre à l'existence humaine
Ce qu'elle contient d'idéal,
Dans le banal jardin où le destin nous mène
Cueillir un bouquet triomphal ;
C'est celle qui connut le fond de toute gloire
De tout amour, pieux ou fou,
celle qui prit la coupe où tant ne peuvent boire
Et qui la vida jusqu'au bout.
Sarah c'est toi, Sarah ! puissante génitrice
Autour de qui naissent toujours
Créés par tes beaux yeux de Muse inspiratrice
Tous les talents, tous les amours ;
C'est toi, Figure, toi Silhouette, ô Camée !
Toi qui donnes et qui reçoit,
Toi qui, modèle, artiste, aimant bien, bien aimée,
Idole et prêtresse à la fois,
Sais faire, aux yeux ravis de la foule anonyme,
Mimant, vivant, vivant, mimant,
Ruisseler ton vrai coeur sur ton masque de mime,
Réellement, fictivement.
C'est toi qui sens le dieu vivre au fond de ton âme,
Mais pour achever ta beauté
C'est aussi toi qu'auguste et sage et douce, ô femme !
Consacra la maternité.
Et toute ainsi de rêve et de réel ; croyante
A tout culte donnant ta foi,
Royale tu t'en vas par cette terre où chante
Tout ce qui peut chanter en toi.
Et tu demeureras à jamais inouïe
Comme joue à joue à côté
De ce que cisela la triste humanité
En masques d'art et de génie.
Proie un soir de mon rêve, ô ma pâleur, ma brune,
Ma grande ! je me veux encor dans des demains
Le coude à tes genoux rejoints pour, une à une,
Compter à tes dix doigts les bagues de tes mains
Dont les chatons changeants couvent des clairs de lune.
Ta robe d'or pompeuse et lourde de son tour
Fleurira largement ses corolles d'étoffe
Et ton chef balanceur de strophe et d'antistrophe
Secouera ta coiffure haute comme une tour ;
Et tu te lèveras aussi parmi la foule
Banale, tout à moi qui seule comprendrai,
Avec ton regard noir hautainement filtré
Sur cette foule, et lourd du mépris de sa houle,
Tu parleras avec le souffle de ton coeur,
Et de ton art à fleur de lèvres, à fleur
De ta beauté, flûtant en mots de calme et d'ombre
Et souriant un rire attendri de bonté,
Et tremblant de tendresse et t'enflant d'âme sombre
Comme un violoncelle où pleure un andanté,
Et t'amplifiant plus en voix qui monte et gronde
Et clame des vers gros d'appels et de fureurs
Et hurle !... Et dans ton geste et cette voix profonde,
Il y aura des cris de haine avant-coureurs ;
La Liberté farouche agitant dans ses voltes
A bout de bras, le grand drapeau fou des révoltes,
La Marseillaise plein la poitrine ; et encor
Il y aura Sapho brisant sa lyre d'or,
Il y aura Carmen blême de tragédie
Intime, les deux yeux dévorés d'incendie,
Tout le sanglot, tout le sursaut, tous les frissons
Et le vent furieux rebroussant les moissons
Et des serpentements de sirène mêlée
A la marée avec son geste large ouvert
Frémissant jusqu'au bout de la traîne étalée,
Terrible et rauque en toi comme toute la mer !
Vos belles mains de race, aux lignes souveraines,
Construites pour mener la vie à grandes rênes
Et dont le geste noble et le rare contour
Evoquent le vieux temps des dames à leur tout,
Pourraient faire blémir l'orgueil de bien des reines.
Que le lourd chapelet y déroule ses graines,
Qu'y mettent les chatons leurs reflets de murènes,
Rien ne vaut, chapelet, bague, pompeux atour,
Vos belles mains.
Pour moi, que prit toujours le charme des sirènes,
Je voudrais, respirant à l'ombre de vos traines,
Qu'une caresse au moins me payât de retour
Lorsque dévotement je serre tour à tour,
- Si pâles dans mes doigts et froidement sereines, -
Vos belles mains !
*
O Dame ! Béatrix pour les versets de Dante,
Belle à la bouche mince où dort le contralto
Au geste pur drapant tes lignes d'un manteau
Mais au charme pervers de Muse décadente ;
O Dame, masque blême où brûlent tes grands yeux,
O Dame, fresque, affiche artiste, silhouette
Au pas sans bruit à fleur de scène, ombre fluette
Que fatigue le poids du chignon orgueilleux,
Psalmodiant les vers étranges et les proses,
Lève-toi devant nous comme un fantôme clair
Et que ta voix d'or monte à tes lèvres décloses,
Afin qu'en t'écoutant, droite et le doigt en l'air
Toute pâle parmi la pâleur des écharpes,
Nos coeurs vibrent en nous comme un concert de harpes.
O Dame ! Béatrix pour les versets de Dante,
Belle à la bouche mince où dort le contralto
Au geste pur drapant tes lignes d'un manteau
Mais au charme pervers de Muse décadente ;
O Dame, masque blême où brûlent tes grands yeux,
O Dame, fresque, affiche artiste, silhouette
Au pas sans bruit à fleur de scène, ombre fluette
Que fatigue le poids du chignon orgueilleux,
Psalmodiant les vers étranges et les proses,
Lève-toi devant nous comme un fantôme clair
Et que ta voix d'or monte à tes lèvres décloses,
Afin qu'en t'écoutant, droite et le doigt en l'air
Toute pâle parmi la pâleur des écharpes,
Nos coeurs vibrent en nous comme un concert de harpes.
Dites, la chaîne d'or qu'entre vos doigts artistes
Vous maniez et balancez,
S'il y pend ces opales tristes
Est-ce lorsque vos yeux sont laissés
Baissés
Pour quand même un rappel de vos prunelles chères
Si claires ?
Contre vous ces bijoux, où revit, croirait-on,
Dans le très peu qu'est un chaton
L'immense qu'est un crépuscule,
Comme une goutte minuscule
Bascule,
Tremblent comme pour choir avec un point brûlant
Au flanc,
Et la lutte s'engage en reluisances vagues
Entre elles et vos glauques bagues
Et vos très fantasques iris
Verts, gris,
Ou bleus suivant l'instant ainsi que l'onde étrange
Qui change.
Mais, lorsque le chagrin mouille votre regard
Ou bien quelque émotion d'art,
Quelle allusion saisissante !
Chaque opale phosphorescente,
Glissante,
Figure l'un des pleurs que distillaient en eux
Ces yeux.
Et, presque, l'on voudrait tendre une main ouverte
A la prunelle bleue et verte
Quand les larmes vont y monter
Pour à ses paumes emporter
Hâté,
Un peu de ces beaux yeux verseurs, flambants et pâles,
D'opales.
Parmi le carillon tombeur de grosses notes,
Monseigneur, apposez, plus blanche que du lait,
La dextre où l'anneau met son éclair violet
Sur les fronts puérils et les bouches dévotes.
Notre bonne cité baisera votre anneau
Et fera bel accueil et fera belle fête
Au passant tout en or avec sa mitre en tête
En qui revit un peu du divin chemineau.
Car nous voyons en vous se mirer Son image,
O Prince ! et si c'est là le plus sensible hommage
Que nous sachions offrir à votre dignité,
N'est-ce pas votre joie intime et principale
Que puisse d'un revers la paume épiscopale,
Oindre les fronts humains d'un peu de Sa bonté
Petits pieds andalous
Parmi l'intimité des fins dessous si flous
Qu'emmène aux quatre points l'allure féminine
Tout ce trotte-menu
Qui dans le cuir luisant et dans le bas ténu
Mord l'asphalte poudreux ou le pavé chenu,
Flâne, court ou gamine ;
Parmi l'intimité des fins dessous si flous,
Petits pieds andalous ;
Petits pieds andalous
Dans l'entrecroisement des faces et des loups
Au bruit des carnavals et des bals, bruits de fêtes
Pris comme en des sachets
Au satin du soulier lourd de colifichets
Valsant, sautant, tournant ainsi que des hochets,
Tournant comme les têtes ;
Dans l'entrecroisement des faces et des loups,
Petits pieds andalous ;
Petits pieds andalous
Faits pour être gardés parmi les doigts jaloux,
Pieds juste à la mesure étreignante des paumes,
Appeleurs de baisers,
Chauds et vivants ainsi que des oiseaux posés,
Jolis comme des mains d'être blancs et rosés ;
Dans la plume douillette et de précieux baumes
Faits pour être gardés parmi les doigts jaloux,
Petits pieds andalous ;
Petits pieds andalous,
Vous qui ne courez point où vont les guilledous,
Je vous aime, petits petons d'honnête femme
Parce qu'en vous s'affirme et s'achève l'attrait
Tout ensemble discret
Spirituel et fin qu'ainsi qu'un doux secret
Garde dans tout son port cette perle : la dame,
Vous qui ne courez point où vont les guilledous,
Petits pieds andalous!
La lenteur de tes pas que suivent les étoffes,
Au sol jonché ramasse une à une des fleurs
Et l'épode te montre au bout des antistrophes
Droite et debout, drapant ta souplesse aux ampleurs
De ta robe en qui meurt toute une gamme bleue
Fraîche de tant de fleurs dans les plis de sa queue.
Et les mille parfums doucement en allés
De ces calices, vont à ta gorge plénière,
Vont à la nudité de tes bras étalés
S'unir à la senteur de ta chair printanière ;
Et le désir humain qui rôde tout autour
De toi son rêve fou d'enlacement farouche
Confie à chaque fleur le baiser d'une bouche
Et dans chaque parfum met un aveu d'amour.
Hélène, je n'ai pas comme vous dans ma vie
La Muse en noir des amours morts ;
Jamais nulle hantise encor ne m'a suivie,
Ni le regret, ni le remords ;
Mon coeur est vierge en moi comme ma chair est vierge,
Il ne porte aucun secret deuil,
L'amour en passant frappe à cette tour d'orgueil
Qui ne se livre ni n'héberge ;
Si je hurle d'angoisse et clame de désir,
C'est que l'existence est méchante,
C'est, devant l'infini que l'on ne peut saisir,
Que je suis toujours impuissante.
Et mes rythmes n'étant pour aucun bien-aimé
S'en vont vers la beauté des choses,
Vers la mer, vers les bois, vers les grands couchants roses
En qui seuls vit mon coeur fermé ;
Et ma Muse nourrie à la même mamelle
Ignorante du tendre émoi
Marche violemment le même pas que moi
Comme une farouche jumelle.
Mais la virilité de ce souffle me fait
Aimer justement la tendresse
Le charme féminin, la douceur, la caresse
Que contient votre oeuvre à souhait,
Et comme au temps jadis s'inclinait jusqu'à terre
Pour la dame le chevalier,
Incliner devant vous ma tête volontaire
Que l'amour ne sut point plier.
Vespérales
Ce jour d'été qui ne finissait pas
Sombre enfin dans un crépuscule magnifique,
Ce jour d'été qui ne finissait pas.
Viens ma camarade mélancolique,
Mon âme ! Et hantons les campagnes pas à pas.
Viens ma camarade mélancolique !
La crudité des matins et des midis
Eclaboussait de trop de soleil notre rêve,
La crudité des matins et des midis.
Mais voici qu'une aube étrange se lève
Au coeur de l'horizon où le soleil descend ;
Mais voici qu'une aube étrange se lève !
Son jour est une allusion au sang ;
C'est une pourpre douce et tiède qui nous baigne;
Son jour est une allusion au sang.
C'est de l'ombre qui s'étale et qui saigne,
Où s'éveille le choeur de tous les lamentos ;
C'est de l'ombre qui s'étale et qui saigne.
Les revenants y traînent leurs manteaux,
On y entend un frôlement de bêtes tristes ;
Les revenants y traînent leurs manteaux.
Oh ! les crapauds et leurs goîtres flûtistes
Et les chats-huants y appelant au secours !
Oh ! les crapauds et leurs goîtres flûtistes !
C'est le réveil des bizarres amours,
Des sourds repentirs, des solitaires suicides,
C'est le réveil des bizarres amours.
L'aube inverse des rêveurs illucides
Pleurant des chagrins faux avec des sanglots vrais,
L'aube inverse des rêveurs illucides.
Et nous, nous y crierons, qui tordons vers l'Après
Dans un geste impuissant nos poignes déicides ;
Et nous, nous y crierons, qui tordons vers l'Après
Notre coeur gros d'angoisse et de mauvais secrets.
A ma soeur Charlotte
Pleine lune qui fais les beaux minuits d'argent,
Glabre qu'aime le soir toute une pauvre gent,
O voyageuse taciturne !
Rôdant sur la grisaille immense des cités
Pour, face à face, y luire aux songeurs attristés
Le front à leur vitre nocturne,
Lune des parcs, des eaux, des fleurs, des chênes tors,
Donne une illusion d'air libre et de dehors
A ceux qui pleurent la campagne ;
Viens, amante pâlotte au regard singulier,
Côte à côte et sans bruit partager l'oreiller
De ceux qui n'ont pas de compagne ;
Coiffe d'une couronne à flamboyants fleurons,
Un instant arrêtée en ta fugue, les fronts
Des stériles chercheurs de gloire ;
Sois une allusion aux galettes des rois
Et la coupe de vin qui tremble dans les doigts
De ceux qui n'ont manger ni boire ;
Surgis dans ta pâleur de cap guillotiné
Grimaçante d'horreur à l'oeil halluciné
De ceux qui rêvent de revanches ;
Vêts du voile de noce issu de ta clarté
Celles qui n'auront pas leur part de volupté
Et que tente la robe blanche ;
Jette aux vieilles beautés avides de butin
Et si veuves ! l'argent furtif et clandestin
De tes taches capricieuses ;
Brille pour les petits apeurés dans leurs lits
Et dont les rideaux ont des bêtes pleins leurs plis
- Comme font les bonnes veilleuses ;
Puis, offre l'hostie alme et lumineuse à ceux
Qui gardèrent l'espoir de paradis fameux
Tout au fond de leur âme pie ;
Et lorsque, visitant ces veilleurs du désir
Tu leur auras ainsi versé de ton plaisir
A même la ville assoupie,
O lune ! garde encore un rayon pour le toit
Où les chats miauleurs ouvrant, clairs comme toi,
Leurs yeux ronds vers ta plénitude
Dans l'équilibre sûr de leur pas de velours
Te prennent à témoin de leurs folles amours
Et sanglotent leur lassitude.
Ci-gît, sans trop s'y résigner,
Une qui battit la campagne.
Son noir cercueil fut le dernier
De tous ses châteaux en Espagne
Et, dans ce logis exigu,
Elle dort, toute jeune encore,
Se reposant d'avoir vécu
Pendant l'espace d'une aurore.
A la chasse d'un espoir fou
On ne sait où,
Nos âmes ! barques en allées,
Barques ailées,
Quand vous saisit l'orage errant
Ou que vous prend
L'ennui morne où l'effort expire
Dans son gris pire,
Nos âmes ! Vous n'entrerez pas
Ranger là-bas
Parmi le vert des paysages
Vos voiles sages,
Aux hâvres des simplicités,
Des piétés,
Des résignations mûrées
Loin des marées,
Offrant, blancs de blanche bonté,
Leur sûreté
Sans que vos fatigues prodigues
Hantent ces digues ;
Car l'angoisse, hors des abris,
Vers les temps gris,
Vers l'orage glauque qui passe
Toujours vous chasse,
L'angoisse du désir dément
L'attrait qui ment
Du Large, O barques, troupe insane,
Ames en panne !
A ma soeur Alice
Parfum évocateur d'absents
En qui l'être bien loin qu'on l'appelle repasse
Comme un fantôme plein de grâce
Et nous reprend d'un coup notre esprit et nos sens,
Parfum, d'une seule fleurée
Redisant tout, regard, voix, geste, allure, pas,
Et ce qui ne s'exprime pas
Du charme qu'émanait sa personne adorée,
Parfum, perle en laquelle tient
Mieux encore que ce quelqu'un, son ambiance,
Toute l'époque d'existence
Qu'on y vécut, passé concentré qui revient,
Parfum, goutte sur la vêture,
Tiédeur d'une présence, haleine d'un baiser,
O toi qui sais nous abuser,
Rends-nous pour un instant la chère créature,
Parfum, bonheur qui te promets
Aux coeurs heureux pour qui l'absence sera brève,
Parfum, hélas ! qui parachève
Le lourd regret des coeurs séparés à jamais !
*
Les beaux jours qui se meurent si tard
Dans les couchants mélancoliques,
Ah ! ces après-midi bucoliques
Où nous traînons notre regard
Et notre pas et notre geste
Et notre contenance et le reste,
La marionnette et tout son fard !
Les beaux jours qui se meurent si tard,
Ces beaux jours d'été, toute leur joie
Est pour les purs et simples coeurs,
Pour les croyances et les vigueurs ;
Mais pas pour nous que l'angoisse noie !
... Et parce qu'en nous rien n'est pareil
A cette fête du beau soleil,
La fleur si triste de nos névroses
N'épousera jamais la chair fraîche des roses.
Pour l'âme en panne point de rive
Où l'on arrive ;
Pour le coeur en deuil
Point d'accueil.
Il faut garder son âme tue
Sombre et têtue
Et son coeur trop gros
De sanglots.
Ce soir, passant le long de la mer retirée
Morne, avec un couchant pâle à son horizon
Et des arbres fanés par l'arrière-saison
Roux aux troncs noirs, tordus sur sa rive effondrée,
En écoutant le bruit monotone et mineur
Des eaux dans les cailloux, il m'est venu ce rêve
De passer avec toi sur cette même grève
Grave et le coeur serré par un vague bonheur.
Je nous voulais marchant auprès des chansons bleues
Du flot, les bras unis avec tous les reflets
Du crépuscule aux yeux, et, parmi les galets,
Traînant derrière nous nos deux robes à queues,
A pas lents, inclinant l'un vers l'autre nos fronts,
Moi toute jeune encor, toi matrone hautaine,
Et sentant, au travers de l'étoffe incertaine,
Côte à côte nos coeurs battre dans nos girons.
Et, regardant au sol marcher l'ombre jumelle
De notre enlacement, pâle, devant la mer,
Je t'aurais confié tout bas mon coeur amer
Troublé, changeant, étrange, insondable comme elle.
A ma soeur Suzanne.
Dormez, bébé ; la nuit est sombre.
Voici rôder, passant dans l'ombre,
Les grands loups au pelage noir.
Avec leur voix étrange et forte
Ils viendront crier à la porte,
Si bébé ne dort pas ce soir.
Dormez, bébé ; le temps fait rage.
Voici passer un grand orage,
On l'entend tout là-bas gémir.
Sur son aile le vent l'apporte,
Il viendra secouer la porte
Si bébé ne veut pas dormir.
Dormez, bébé ; l'ange vous veille.
Quand l'enfant doucement sommeille
Il lui dit sa chanson tout bas ;
Mais il serait triste et, sur l'heure,
S'envolerait de sa demeure,
Si bébé ne s'endormait pas.
Fredonnez, les deux mains traînant au piano
Et les yeux noyés dans le vague,
Si vagues vos grands yeux vagues comme la vague
Et si vagues vos doigts libres de tout anneau !
Fredonnez, les deux mains traînant au piano.
Caresse aux doigts, d'ivoire, et de charme à vos lèvres,
Musicale frôlée au coeur,
Chant tout bas, si majeur, si mineur, si moqueur,
Menuet et sanglot perlé de notes mièvres,
Caresse aux doigts, d'ivoire, et de timbre à vos lèvres ;
Charme comme d'entendre à travers la cloison
Chanter une voix inconnue,
Charme d'une chanson on ne sait d'où venue
Par qui sont dans les yeux les larmes sans raison,
Charme comme d'entendre à travers la cloison ;
Trouble d'un baiser pris et dont on ne regoûte,
Enervement de l'incomplet,
Fantôme comme aux eaux les choses en reflet,
Volupté du regret, du souvenir, du doute,
Trouble d'un baiser pris et dont on ne regoûte.
Fredons où l'âme écoute en cherchant à saisir,
Vos fredons si légers, si tristes !
A cause du mystère en eux fredons artistes,
Fredons chers pour laisser après eux un désir,
Fredons où l'âme écoute en cherchant à saisir.
Vivantes roses de bel âge
Qui hantez la maison du clair de vos visages,
Du roux occidental de vos rudes toisons
Où toujours fait sa roue une fleur de saison ;
Vous, croupes de sirènes ;
Vous, majestés que suit l'arrogance des traînes ;
Vous, idoles, avec les étoiles fugaces
Des colliers de vos cous, de l'or de vos oreilles ;
Vous fards, fraîcheurs d'emprunt sur la fraîcheur des faces
Où sous vos sourcils longs d'allongent vos prunelles,
O princesses, ô demoiselles !
Songez-vous que, les jours ayant suivi les jours,
Dans la maison, déjà si vielle avec autour
Son parc mystérieux qui verdit tour à tour
Ses étés et s'effeuille en ses automne d'or,
Toutes vous passerez le long des corridors
Les nuits que le vent crie aux portes comme un loup,
Esprits clairs revenus en rang on ne sait d'où
Pour, sans contours ainsi que la brume des soirs,
Grimacer vos beautés au profond des miroirs ?...
Ce soir, Hamlet en deuil sort de l'encrier noir.
Il vient, me regardant jusqu'au fond des prunelles,
Mettre dans mes deux mains ses paumes solennelles
Et s'asseoir près de moi blême de désespoir.
Doux prince, j'aime bien mes mains dans vos mains pâles,
Le glauque de vos yeux pensifs d'homme du Nord,
Votre grand manteau noir frère des manteaux d'or
Où l'améthyste a mis ses fleurs épiscopales.
Un souvenir lointain erre dans votre deuil,
Pareil à la senteur des choses qu'on exhume ;
La Légende ineffable a laissé de sa brume
En vous qui la quittez pour paraître à mon seuil.
Je baiserai vos mains ce soir inoccupées
Où l'encre mit d'abord son stigmate innocent,
Dont ensuite le sort tacha les doigts de sang,
Eux manieurs de plume et non porteurs d'épées.
Je poserai mon front contre votre front lourd
Car tous deux, ennemis du faste et du tapage,
Nous nous sommes penchés sur une même page,
Avec la même angoisse, avec le même amour.
Nous avons tous les deux songé les mêmes songes,
Nos faces ont pâli sur les mêmes labeurs
Et nous avons aussi versé les mêmes pleurs
Sur les mêmes humains et leurs mêmes mensonges.
Vous me raconterez votre spectre anxieux,
Je vous dirai le mien qui me suit à la piste
Car je suis folle aussi d'entendre sa voix triste
Et de sentir toujours ses deux yeux dans mes yeux.
Car, comme votre père aux injonctions brèves,
Impérieux et froid le Suicide est là ;
Car tous deux, inquiets d'un semblable au-delà,
Nous n'obéissons pas à cause de nos rêves !
Ah ! les rêves !... Toujours toujours rêver en vain
Et toujours agrandir ses deux yeux dans le vide
Et toujours revenir à sa pensée avide
Comme l'ivrogne affreux qui retourne à son vin !
Toujours l'atroce mort quand le corps va s'étendre
Mêlant l'allusion du néant au sommeil
Toujours le même sombre et soucieux réveil
Où l'horreur d'exister encor vient vous reprendre !
Ah vivre !... vivre en paix, vivre en simplicité
Sans chercher à sonder notre propre mystère,
Sans cris vers l'Infini qui persiste à se taire ;
Ah vivre !... vivre !... Ou bien alors n'avoir jamais été !
Doux prince, approchez-vous. Vous n'êtes qu'un fantôme
Mais puisque, comme vous j'ai rêvé quelquefois,
Puisqu'aussi sous mon front ma pensée a le poids
D'un monde dont le faix tiendrait dans un atome,
J'aime le manteau noir frère des manteaux d'or
Où l'améthyste a mis ses fleurs épiscopales
Et contempler longtemps, les mais dans vos mains pâles
Le glauque de vos yeux pensifs d'homme du Nord...
A ma soeur Marguerite.
L'écrin nocturne des yeux bizarres
S'est répandu à même la nuit.
Vaguement, c'est autour des écrins et des mares
L'écrin nocturne des yeux bizarres.
Les yeux ouverts on ne sait où,
Ronds de clarté, cligneurs de félinerie,
Aigus d'or, larges de rêverie ;
Grands yeux en promenade du hibou
Et du chat miauleur d'hystérie
Et du somnambule en équilibre et du fou
Ballant sa frôleuse vespérie
Et dans l'éloquence à mi-vois de la nuit,
- Goutte à goutte qui choit à petit bruit -
Une note unique et monotone détonne
Du fond de la laideur squammeuse des crapauds,
Les crapauds au pas qui tâtonne,
Riches de deux yeux d'or dans l'horreur de leurs peaux.
Ah les yeux ! les yeux fous des bêtes une à une
Dardés immensément vers le ciel bleu de nuit
Qui sur leur rondeur arrondit
L'oeil ouvert de la pleine lune !
Sans qu'on t'ait entendue, ombre, comme un félin
Qui s'avance au pas lourd de ses pieds hypocrites,
Tu t'approches, berçant tes hanches sybarites
Et plonges dans mes yeux ton regard opalin.
Le léger mouvement de strophe et d'antistrophe
Dont tremble ta coiffure haute comme une tour
Fait se dissimuler et pointer tour à tour
Les deux fleurs de tes seins sous les fleurs de l'étoffe ;
De lourds chatons ont fait tes doigts exorbitants,
Ton cou porte en colliers des ampleurs de rosaires,
Et des calices nés dans d'innombrables serres
Ornent tes cheveux noirs d'un bizarre printemps.
Le cerne de tes yeux s'étend et s'accentue
Et meurtrit largement ta morbide pâleur
Où, fraîche, vénéneuse et tentatrice fleur,
Eclate la rougeur de ta bouche ambiguë.
Que veux-tu ? Tu répands des baumes et des nards
Et ton geste m'enlace ainsi qu'une couleuvre ;
Dans tes iris changeants toujours guette une pieuve
Qui m'a déjà tentée au fond d'autres regards.
Tes lèvres m'ont souri sur celles d'autres femmes
Et d'autres bras tendus m'ont montré le chemin
Mystérieux et noir que m'indique ta main,
Toi que je ne suis pas comme tu le réclames.
C'est un chemin étroit qui longe inversement
La grande route droite où cheminent les couples ;
Il s'étale et sinue entre les tiges souples
De fleurs qui ne sont pas pour des bouquets d'amant.
C'est un chemin étroit tentant pour qui s'ennuie,
A qui tout le banal humain est en dégoût,
Et l'âme vagabonde y respire partout
Un ignoré parfum d'aventure inouïe...
Mais je ne suivrai point ton pas silencieux ;
Je n'ai rien écouté d'une voix plus puissante,
Je n'entends pas non plus ta voix pervertissante
Et le Livre aura seul mon coeur sentencieux.
Que d'heures qui s'en vont au passé pas à pas
Où, nés pour être deux, seule chair et seule âme,
N'ayant ni noces ni divin épithalame,
Ceux qui devraient s'aimer ne se connaissent pas !
Que d'heures ne laissant de parfum ni d'annales,
Et faites pour l'extase et le néant d'amour,
Que de nuits, que de nuits se perdent sans retour,
Que de splendides nuits banales ou vénales !
Ah ! de songer aux mots qui les auraient grisés
Parmi le clair de lune écoutés bouche à bouche !
De songer qu'ils vivront sans que leur main se touche
Et que, pour eux, ces nuits passeront sans baisers !
Je rêve par les nuits à l'amour qui sanglote,
Amours non sus, amours trahis,
Amants qu'on n'aime pas, ou pire, amants haïs,
Pleurs de paria, pleurs d'ilote.
Je rêve à vous, cheveux blanchissants sur les fronts,
Poings qu'on enfonce sans les bouches,
Détresses dans secours qui pâmez sur des couches,
Coeurs qui saignez dans des girons.
A toi, lente insomnie ouvreuse de prunelles
Dans la muette obscurité,
Où la mort qui sourit tend ses mains fraternelles
Et tout bas parle du Léthé !
Et telle que serait quelque oraison nocturne
Sans signe de croix et sans mots,
Ma pitié va roder à l'entour de ces maux
Comme un fantôme taciturne.
... Ah! qu'au moins, ah ! qu'au moins dans leur être béant
Où le glas de la mort bourdonne,
Le sommeil un instant descende, puisqu'il donne
Comme un avant goût du néant !
Mon âme s'ouvre au soir comme une fleur bizarre
Qui s'épanouirait à l'heure du couchant,
Et, quittant le tombeau du corps, heureux lazare,
Monte à Dieu comme y vont l'encens et le plain-chant.
Je ne voudrais alors le baiser sur ma bouche,
L'étreinte me pressant l'épaule dans le noir,
Que pour me figurer un instant que je touche
L'au-delà que j'adore et que je ne puis voir,
L'amant n'étant pour moi, dans cette heure suprême,
Que mon rêve éternel subitement fait chair,
Qu'un être me donnant, l'espace d'un éclair,
L'illusion de dire à l'Infini: " Je t'aime !"
Ta patience a lui sur d'inouïs passés,
Face morte et nocturne au firmament qui sais
Le mystère profond des foules disparues,
O lune des champs et des rues !
Et quand le ciel s'argente à ton ascension,
Notre âme où s'est levée aussi ta plénitude
Ouvre sur toi deux yeux d'interrogation
Ronds d'angoisse et d'inquiétude,
Songeant ces regards-là qui virent tes soirs purs,
Et ceux-ci qui luiront ta lumière mouillée,
Alors que dormira notre race oubliée
Sous l'amas des siècles futurs.
Tristesse du petit jour,
Frôlement aux carreaux mornes, morne filtrée ;
Aux volets joints clarté, comme de lune, entrée
Sans luisance à travers les fentes du bois lourd ;
Tristesse du petit jour,
Lueur sans charme au fond de l'inerte campagne
Et qui, dans le silence, en silence aussi stagne,
Faible, laissant encor les choses sans contour ;
Tristesse du petit jour
Sur les villes sans bruit que le repos fait mortes,
Le sommeil n'ayant pas relâché leurs cohortes
Passantes, par la rue et par le carrefour ;
Tristesse du petit jour
Dans la chambre où vacille une lutte ennuyeuse
D'ombre burlesque avec la dolente veilleuse
Comme, au plafond, un ciel clair et noir tour à tour ;
Tristesse du petit jour
Sur les sommeils, néants dans les oreillers souples,
Sombres, naïfs, vénals, malades, ceux des couples,
Rideaux fermés, sommeils lassés, sommeils d'amour ;
Tristesse du petit jour
Sur la mer grise et large et largement étale...
Oh l'appel ! Oh ! le cri, parmi le brouillard pâle,
Trouble, double, que jette un bateau de retour !
Oh ! l'horreur de sortir des bons rêves mythiques,
D'avoir à vivre encore une fois tout un jour,
O tristesse du petit jour
Sur l'ennui, large ouvert, de deux yeux spleenitiques !
Puisque tu ne veux plus m'aimer, indifférente,
Et puisque rien ne peut, froide, te réchauffer,
Je veux, quand tu viendras, crisper ma main errante
A ton beau cou d'ivoire afin de t'étouffer.
Ou plutôt, comme la pitié pourrait me prendre
A voir ta bouche blême et tes bras débattus
Et qu'une horreur viendrait me saisir à t'entendre
Râler des mots d'effroi graduellement tus,
Je veux, ainsi qu'après une étreinte donnée,
Et me penchant sur toi comme pour un serment,
T'enfoncer dans le coeur l'épingle empoisonnée
Qui sans geste et sans cris tue hypocritement.
Ou plutôt, ou plutôt, adorée, adorée !
Si tu daignes, sans cris, sans discours, sans assauts,
Epanchant sur tes mains ma tristesse pleurée,
J'y laisserai couler mes larmes en ruisseaux.
Contempteur de la vie un lourd crucifix jette
D'un grand geste mélancolique,
La sombre allusion de la mort catholique,
Tandis qu'ainsi la nuit y verse ses écrins
Et fleurit ce sommeil de ses bijoux païens.
I
Comme une que berça la viole d'amour;
La belle tout en pâleur dort,
Les volets joints avec, dessus, les rideaux lourds
Pour empêcher sur sa tranquillité de mort
Que ne vienne jouer l'estival clair de lune.
Mais des gouttes de lune ont chu une par une
Aux fentes de ces volets joints
Et luisent sur sa couche aux draps finement oints,
Comme si les colliers de sa parure pâle
Avaient dans la ténèbre égrené des opales.
Et, sur ses seins quiets où se croisent les paumes,
Sur ses pieds sages réunis,
Sur tout le luxe prude et raffiné du lit
Où elle se coucha sans bagues et sans baumes,
Le corps sans robe d'or et sans huppe à la tête,
Contempteur de la vie un lourd crucifix jette,
D'un grand geste mélancolique,
La sombre allusion de la mort catholique,
tandis qu'ainsi la nuit y verse ses écrins
Et fleurit ce sommeil de ses bijoux païens.
II
Les pierres des colliers s'éteignent une à une
Dans cette nuit fatale où ne luit pas la lune.
Endors-toi longue sur ta couche
Avec tous tes colliers éteints autour du cou,
Avec l'âme on ne sait où,
Avec une fleur à la bouche,
Avec tes bagues d'art jusqu'au bout des phalanges.
La veilleuse a forgé des fantômes étranges
De son vacillement qui rampe par la chambre
Et fleurit le plafond de grands astres muets
Et remue, aux recoins, des ombres qui dormaient.
repose jusqu'au jour ; à moins que, pour te voir,
Dans tout ce clair obscur en agitation,
Ne vienne sur tes seins tout doucement s'asseoir
Le chat noir inquiet de ton sommeil profond
Qui fixera sur toi, dans la tiédeur des plumes,
Ses deux yeux ronds et clairs comme deux pleines lunes...
La ville s'illumine au lointain à fleur d'eau
Tout au bout de la mer nocturne ;
Lève ta tête basse, ô triste,ô taciturne !
Le couchant furieux s"apaise à l'horizon
Au-dessus de la mer éteinte ;
Regarde, ô coeur gonflé de plaintes !
Lève la tête, vois! Ainsi qu'un long collier
La ville brille dans le soir,
Contredite dans l'eau comme dans un miroir.
Les tours luisent, voici les châteaux qui s'allument,
Voici les palais qui flamboient ;
Ah ! de la joie, ah ! de la joie !...
C'est la ville du bout du monde, c'est Thulé,
C'est le conte bleu, c'est le rêve ;
Appareillons ! Partons vers ces lointaines grèves !
Puisque notre vaisseau tourne déjà sa proue
Et comme pour un vol gonfle déjà ses voiles
Vers ce là-bas riche d'étoiles,
Monte et partons ! Tes yeux pleureront de bonheur
En grosses larmes sur la mer.
Nous avons tant souffert, nous avons tant souffert !
Mais nous aborderons la Ville où nous attendent
Nos désirs irréalisés
Et nos pauvres espoirs brisés.
Nous allons vivre !... Ah dis, lève-toi, chante-moi
Quelque hymne les deux bras ouverts
Dans ton manteau de deuil qui traîne dans la mer ;
Car voici qu'on peut voir déjà monter la tour
Où l'être te fait signe enfin
Dont tu eus si soif et si faim ;
Toute puissance d'homme et tendresse de femme,
Voici sa bouche pour ta bouche,
Ses deux bras insensés pour ton amour farouche,
Sa bonne épaule pour ton front lourd de pensée,
Son coeur pour ton coeur gros de sève,
Ses deux yeux profonds pour tes rêves ;
Sa voix parle, son oeil voit, son oreille entend,
Toute une âme compréhensive
Veille ; attendant ton âme, en sa beauté pensive ;
Et c'est ta paix et c'est ton amour, c'est ta joie,
Ah ! de la joie, Ah de la joie !...
cette cité qui met ton désir sur lamer,
O coeur pudique, ô coeur pervers, ô coeur amer !...
A jamais ainsi qu'une petite morte,
Mon enfance dort dans la ville qui dort.
A jamais ainsi qu'une petite morte,
Elle dort au clapotis des eaux du port
berçant les mâts des barques dans les étoiles.
Elle dort au claquement rude des voiles
De vaisseaux revenus de lieux inouïs.
Elle dort au claquement rude des voiles
Qui parle des plus ignorés pays,
Et son sommeil en est plein de belles fables.
Elle dort de ses deux grands yeux misérables
Gardant comme un souvenir du paradis.
Elle dort de ses deux grands yeux misérables
Et qui s'étonnent peu à peu agrandis
Sur la laideur des choses de la terre.
Elle dort déjà complexe et solitaire,
Inquiète à travers sa naïveté,
Elle dort déjà complexe et solitaire.
le monstre dont son coeur fou sera hanté
L'impossible désir est dans l'oeuf encore...
Elle dort !... Ah dors, dors ! candeur, fraîcheur, aurore !
Les clochers ont perdu leurs pointes dans la nuit.
Des princesses en rang s'avanceront sans bruit,
Ombres passant dans l'ombre,
Hauts de bonnets hauts sur des chefs clairs ou sombres.
La lente extinction de leurs yeux mal cachés
Tremblera sur leur joue en longs cils catholiques ;
Leur mutisme fera leurs bouches hermétiques ;
Leurs doigts prudes seront contre leurs seins vivants,
Claustrés sous la lourdeur des robes hivernales,
(Spectres pointus parmi les pointes des cloches,
Défilé sans couleur qui s'allonge en rêvant.)
Et seuls sur leurs cous nus - violets, jaunes, rouges,
Verts et bleus - frémiront dans l'ombre générale
Leurs colliers contredits dans des lueurs qui bougent,
Quand aussi tremblera, lointain, en haut, si haut !
En l'immensité vespérale,
Le premier diamant d'une petite étoile...
*
Du fond de notre coeur accablé de beauté,
Nos admirations sourdes et solitaires
Montent dévotement leurs muettes prières
Vers nous ne savons pas quelle immortalité.
Et c'est trop de grandeur pour notre infimité
Lorsque les couchants fous qui saignent sur les villes
Ou sur l'ampleur des mers ou les monts immobiles
Ou la forêt tragique ou les blés inclinés
Nous tordent malgré nous nos bras passionnés...
Ah ! le mal de frémir jusqu'aux dernières fibres !
Ouvrir les yeux trop grands sur les choses qui sont !
Défaillir et qu'en soi croulent des équilibres
Parce qu'un beau jour meurt à même un ciel profond !
Nous laisserons au gris des pages refermées
Du Livre où s'obstinaient nos fronts sentencieux
Tout le désir et tout l'effort, les soucieux
Songes et l'ennui lourd des heures enfumées.
Lasses de chair en qui se meurent des avrils,
Lasses de regards fous de rêve et d'harmonie,
Lasses d'âmes où trop de raison cherche et nie,
Nous voulons gaspiller des moments puérils.
Lentes de par le faix maladif de nos têtes,
Hanteuses des jardins dans leurs tours et détours,
Nous irons, de l'étable aux bonnes basses-cours,
Respirer la torpeur bien portante des bêtes.
La couleur saine a peint aux pigeons l'éventail
De leur queue, a fardé les poules promenées,
Et nous guérit un peu des nuances mort-nées ;
La simplesse regarde aux grands yeux du bétail ;
L'herbage réservé pour les vaches laitières
A de l'herbe et des fleurs qui vont jusqu'aux genoux ;
Toute la vie heureuse au soleil monte à nous
De la senteur féconde et chaude des litières.
Myopes, bougonnant ente eux, viennent nous voir
Les porcs bouffis groupés sur le seuil de leur bouge :
L'ombre des cages luit tout à coup de l'oeil rouge
Des placides lapins de neige au museau noir ;
Le vieux mur berce au vent toutes ses giroflées,
Le toit, sous son chapeau de lierre captieux,
Nous voit par ses carreaux, dardés comme des yeux,
Et rit par ses moineaux aux joyeuses volées,
Et, d'avoir tant menti dans un monde qui ment,
Fera nos cils noyés sous des larmes de joie
Quand le chien, dont vers nous la bonne humeur aboie,
Accourra nous lécher les mains naïvement.
Quand les soirs furieux stagnent leurs mornes flammes
A même l'horizon des villes et des champs,
Alors sont arrondis sur les soleils couchants
Les yeux humains remplis du mystère des âmes.
Ils pleurent le regard triste des exilés
Songeant les nords et les midis de leur enfance
Et des soleils pareils versant leur abondance
De pourpre à des lointains autrement profilés ;
Ils pleurent le regard des amours terminées,
Le regret des amants autrefois abattus
Longtemps contre l'épaule offerte à l'heure où, tus,
Leurs couples venaient voir se mourir les journées ;
Ils jettent le coup d'oeil d'incompréhension
Des passantes banalités indifférentes
Et le coup d'oeil aussi des misères errantes
Qui n'ont plus de regard pour l'admiration.
Ils clignent le plaisir paisiblement artiste
Qui s'attarde aux chaos changeant de la couleur
Et la mélancolie émue en sa pâleur
De ceux que la beauté divinement attriste.
Ils luisent de l'espoir des grands tragédies,
Les yeux, les deux yeux fous qu'ouvrent les révoltés
vers l'allusion rouge aux cieux ensanglantés
De leur rêve flambant déjà ses incendies ;
Et les deux yeux aussi de la dévotion
Lèvent sur les couchants leur douceur extatique
Et déjà voient brûler l'heure apocalyptique
Où s'éploiera l'essor de notre assomption.
Du fond des champs, du fond des palais et des bouges,
Comme ceux des hies, comme ceux des demains,
Ah ! ce qu'ils voient ! tout ce qu'ils voient, ces yeux humains
dardés sur la splendeur des larges soleils rouges !
Le refrain lamentable et long d'une berceuse
Balançait le dolent roulis de mon sommeil,
Voix de femme qu'ennuie un chant toujours pareil ;
Et les rideaux &tant fermés et la veilleuse
Fantasque dandinant des ombres aux recoins,
Moi, petit être au fond du nid, fermant les poings,
Aux yeux où la candeur puérile s'étonne,
Dans ce demi-jour vague et ce chant monotone
Je m'éveillais avec la détresse, la peur
De la veilleuse folle et du refrain pleureur,
Comme souffrant, au fond d'une âme déjà triste,
Le lent mal d'exister que personne n'assiste...
*
L'enfance gardera le secret de ses songes,
Son petit coeur profond qui ne s'explique pas;
L'e,fa,ce ne sait point les mots et leurs mensonges,
Elle sent, elle écoute, et regarde tout bas.
Quand les yeux puérils éteignent leur lumière
Sous le voile rusé des cils adolescents,
L'enfance morte emporte au passé funéraire
Son trésor ignoré dans ses doigts innocents.
Mais l'adulte rancoeur de la vie hypocrite
Se souvient en pleurant de ces rêves partis
Comme font, sanglotant leur douleur émérite,
Les mères qui s'en vont aux tombeaux des petits...
La lune était aux cieux à l'heure de minuit
Comme une grande perle au front noir de la nuit.
Tout dormait et j'étais comme seule sur terre.
J'ai regardé la lune étrange et solitaire
Sur laquelle , Sapho, se sont fixés tes yeux
Aux temps antiques quand, de ton pas orgueilleux,
Tu hantais par les nuits l''île coloniale,
Toute seule, levant ta tête géniale
vers le ciel où mettait l'astre son pâle jour.
C'est alors qu'à ta lyre, ô Muse de l'amour !
O Muse du désir et des folles tendresses,
Frissonnaient tes beaux doigts habiles aux caresses
Et que chantait parmi la marée et les vents
Ta bouche ivre aux baisers complexes et savants...
Oh ! de songer tout bas qu'à cette lune blême
Tes yeux s'étaient rivés, grande Sapho, de même
Que les miens quand, parmi le sommeil de la nuit,
Je veillais seule avec mon éternel ennui !
Prêtresse de l'amour qu'ils appellent infâme,
O Sapho ! qu'a donc pu devenir ta grande âme ?
Sous la lune qui vit ta joie et ta douleur,
Je t'ai chantée, aimée, admirée en mon coeur,
Moi poétesse vierge, ô toi la poétesse
Courtisane, ô toi l'aigle orgueilleuse, l'Altesse !
Des cloches pleurent dans la brume.
Il pleut des feuilles d'or qu'un rai furtif allume.
Des cloches pleurent sans finir
Pour tout ce qui s'en va sans jamais revenir.
Quelle agonie immense et triste que l'automne !
La mer entre les arbres las
Monte au loin sa marée exacte et monotone,
Mêlée au rythme de ce glas.
Demain les morts : demain la fête de la tombe...
Oh ! ce glas lugubre qui tombe
A coups sourds dans mon coeur solitaire et béant !
Oh ! m'en aller ! Oh le néant !...
Le croyant contemplant la beauté d'un beau jour
Sent du fond de son coeur monter un chant d'amour
A sa bouche, et ses mains instinctives se joignent,
Car les émotions profondes qui l'empignent
Font son âme voler en admiration
Au ciel où vit le Dieu de sa dévotion.
Et l'amant, contemplant un beau jour, sent de même
e son coeur à sa voix monter le nom qu'il aime
Et son âme, aussi; vole en adoration
vers la divinité de sa dévotion.
... Moi, je ne suis ni la croyante, ni l'amante,
Hélas ! vers aucun but mon âme ne s'aimante
Et le trouble qu'éveille en moi quelque splendeur
Fait ma voix plus muette et plus triste mon coeur.
Mon coeur pleure et mes yeux ne veulent pas pleurer...
Oh ! sentir mon chagrin ruisseler sur ma joue,
Ma bouche se crisper d'une suprême moue
Et, sur mes mains, le froid de mes larmes errer !
Mais pendant que je vais par les bois toute seule
De corps et d'âme, avec ma face sèche, veule,
Le sein gonflé du mal de n'avoir pas d'espoir
Ni présent, ni futur ; du mal de ne rien voir
De bon dans le monde et de ne pouvoir comprendre
Ce qui viendra lorsqu'il sera réduit en cendre,
Du mal de ne savoir que croire et qu'adorer,
Mon coeur pleure et mes yeux ne veulent pas pleurer.
Ainsi qu'un revenant pâle et vêtu de noir,
Le spleen lent près de moi s'est assis à ma table ;
Et j'ai pris à deux mains ma tête lamentable,
Ne pouvant plus rêver, espérer et vouloir.
Rien ne peut m'en guérir, rien ne peut m'en distraire,
Tout mon être est en proie au morne compagnon ;
Qu'on m'offre d'exister ma plus belle chimère,
Sans force pour parler, mon geste dira : "Non !"
Ah ! puisque je ne peux inventer la musique
Lugubre en qui chanter ce mal quotidien,
Je voudrais le hurler longuement comme un chien
Sous la lune, perdu, maigre, transi, phtisique,
Et puisque je ne peux le mourir, je voudrais
Le dormir nuit et jour dans mon oreiller moite,
Silencieusement, volets clos, sans arrêts,
Pour une allusion à la dernière boîte.
Cloches folles au loin dans le bleu des midis,
Grondeuses d'angelus à l'oreille incroyante,
Quelle mémoire vient en nos coeurs engourdis
Réveiller le regret que votre voix nous mente ?
Quel souvenir d'exact, lent cérémonial
Soudain lève un passé d'enfance catholique
Et troue avec un vieux clocher mélancolique
Le blanc pur et les bleus d'un ciel provincial ?
Oh ! fuir hors ton enfer où brûle la pensée,
Paris ! parce qu'il chante à travers la croisée
Un peu de carillon avec du vent entré,
Et retourner sans bruit vers la messe naïve,
Portant un livre lourd où le doigt sage suive,
Sans comprendre, un latin barbare de curé !...
*
Mes vices sont venus me prendre par les mains
Ils m'ont fait voir de bizarres chemins,
Des routes où cueillir des heures inouïes,
Mais je ne les ai pas suivies.
Mes vertus m'ont fait voir des routes qui s'en vont
Montant toujours avec, au bout du mont,
L'incroyable clarté des splendeurs infinies,
Mais je ne les ai pas suivies.
J'attends que vienne en moi le rire de mon âge
Pour te donner tous mes fruits mûrs, plus savoureux
Que les pêches tombant sans effort au passage
De la paume qui veut leur rondeur à son creux,
Lourde de chair jutant à fleur de leur peau moite.
Car déjà, quoique bien vierge, chaste et benoîte,
J'ai la mélancolie au fond de mes iris
D'avoir longtemps suivi la route et d'avoir pris
Une à une ses fleurs dans mes mains enrichies
Qui ont tenu dans des bouquets tout le printemps
Et tout l'automne roux de feuilles défraîchies.
Et puis la mer rythmique, où j'ai rêvé longtemps,
A chanté toute sa signifiance profonde
En moi, et ses couchants furieux ont grandi
Dans mon âme toujours plus ample, et j'ai redit
Sa douceur qui chuchote et sa houle qui gronde.
J'ai senti jusqu'au fond de mon coeur, et jusqu'au fond
Mes sens dans les douleurs, les calmes et les joies ;
J'ai fait prier l'amour, geindre la passion ;
Mes doigts ont déchiré des coeurs comme des proies
Et mon oreille fut le confessionnal
Où parla haut le bien et parla bas le mal.
Et parce que j'ai eu toute l'Intention
Bonne ou perverse au bord de mes instincts perplexes,
Et sue toute la vie aux canevas complexes
A livré son secret à ma réflexion,
Aucun étonnement n'atteint mes équilibres.
Mes nerfs se sont comptés jusqu'aux dernières fibres
Sous l'archet frissonnant de la sensivité ;
La musique et les vers et l'art et la beauté
Et le baiser qui passe à fleur d'âme et de bouche
Ont gonflé leurs sanglots au profond de mon coeur,
Et, tour à tour, de l'aube au soleil qui se couche,
J'ai couru mon désir et flâné ma rancoeur.
L'abstraction aride a creusé ma pensée
D'un bout à l'autre et sans répit, comme u labour,
Et j'ai grandi les yeux de mon âme angoissée
Dans l'horreur du mystère humain, et, tour à tour,
Fait rire vers le ciel et sangloter mon doute.
Et maintenant je suis celle qui vient à toi
Qui me montres au doigts le jardin et le toit,
Ami aux bras ouverts en travers de la route
Où nous allons marcher, lents de geste pâmé.
Je suis celle qui, pour n'avoir jamais aimé,
Ne peut encore pas se connaître soi-même,
Et qui veut dans tes bras savoir comment elle aime,
Celle dont des vingt ans font flamboyer les yeux,
mais dont l'âme, ainsi qu'un violon douloureux,
A senti s'en aller et revenir en elle
Comme un rythme incessant la vie universelle,
Et qui va sur ton coeur mesurer son contour
Toujours fuyant, chercher où sont ses propres bornes,
Sonder son être tel qu'un océan d'eaux mornes,
L'espace d'un bonheur, l'espace d'un amour !
Fin
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 176 autres membres