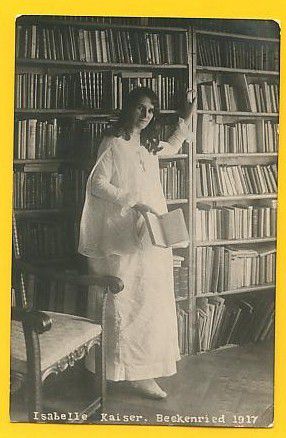Kaiser (Isabelle) 1866-1925 Suisse
Isabelle Kaiser
1866-1925
Bibliographie (poésie française)
1887: La catastrophe
1888: Ici-bas
1893: Fatimé
1897: Des ailes
1920: Le jardin clos
Les morts
A la mémoire de M. F. Payot
Les Morts ne dorment pas couchés sous la poussière,
Leur cendre ne gît point dans les urnes d’airain,
Le cortège des Morts se déroule sur terre,
C’est la procession des calmes pèlerins.
Les Morts viennent à nous quand le deuil nous accable,
Frôlant de leurs pieds nus les nuages altiers,
Ils sont dans la tempête et dans l’air ineffable,
Ils sont l’ombre qui suit nos pas sur les sentiers.
Les Morts bien aimés sont les vivants de la veille,
Hier encor, sous le joug leur échine a ployé,
Et tous, frères, amis, quand la maison sommeille,
Reviennent à pas lents s’asseoir à nos foyers.
Car nous sommes les Morts des aurores prochaines,
Déjà le jour pâlit, et quand viendra le soir
Calmes, nous sortirons du Vallon de nos peines
Par le même chemin qui conduit au Revoir !
Les Morts aimés sont les hôtes aux mains discrètes
Qui demandent leur pain quotidien, sans bruit,
Ils ne viennent jamais nous troubler dans nos fêtes,
Mais veulent partager l’angoisse de nos nuits.
Quand à l’aube un rayon vient déchirer nos brumes,
Ils écartent un peu le voile de leurs fronts,
Leurs grands yeux pleins de paix sondent nos amertumes,
Et s’attristent parfois lorsque nous les pleurons.
Les Morts ne dorment pas couchés sous la poussière,
Leur cendre ne gît point dans les urnes d’airain,
Le cortège des Morts se déroule sur terre…
C’est la procession des calmes pèlerins.
Beckenried, lac des Quatre-Cantons.
Luna
C’est en levant les yeux que j’ai trouvé l’Amie
Qu’ici-bas mon regard rechercha vainement ;
Elle est venue à moi quand j’étais endormie
Et mon rêve a grandi sous son rayonnement.
Vous la voyez passer, bruissantes feuillées,
Elle répand sur vous son sourire indulgent,
Et durant les combats des nocturnes veillées
Pour elle tous mes pleurs sont des perles d’argent.
Elle porte un habit tissé de clartés blanches
Et traîne dans ses plis d’indicibles douceurs.
Elle connaît les nids blottis au sein des branches
Et les noms fabuleux des étoiles, ses sœurs.
Elle incline sur moi la tendresse touchante
D’une mère qui berce un enfant favori,
Et quand, dans la douleur, comme un cygne je chante.
Elle écoute en silence et n’a jamais souri.
Lorsqu’elle vient à moi sur les vagues houleuses.
La grande paix des eaux lui conte son secret ;
Son cortège est l’essaim des pâles nébuleuses
Et l’ombre m’envahit lorsqu’elle disparaît.
Elle est la sœur du rêve et l’idéale amie
Qui ne me parle pas d’un monde que je fuis
Et laisse retomber mes heures d’insomnie
Comme des gouttes d’or dans la coupe des nuits.
Loin d’elle, chaque soir, je guette sa venue ;
Quand elle ne vient pas j’ai des pleurs dans la voix.
Et les chaudes lueurs d’une flamme inconnue
S’allument dans mes yeux lorsque je la revois.
Je ne croiserai point ses pas sur cette terre,
Car le Maître éternel a tracé son chemin,
Elle doit, en tout temps, graviter, solitaire,
Et jamais, non jamais, je n’étreindrai sa main.
Quand loin de sa clarté j’ai la mélancolie,
Elle vient, à pas lents, au cours de mon sommeil,
Jeter, en souvenir du pacte qui nous lie,
Dans les sentiers d’azur son anneau d’or vermeil.
Dans l’ombre de l’exil, où j’ai vécu, farouche,
Son regard infini partout me poursuivait.
Et lorsqu’elle venait prier près de ma couche.
J’ai cru voir la Pairie assise à mon chevet.
Fidèle jusqu’au bout à sa tendresse fière,
Elle seule viendra dans la nuit de l’oubli
Traîner ses voiles blancs au fond du cimetière
Et baiser sur la croix mon petit nom pâli.
La ronce
Sonnet double
I
La ronce, en ces temps-là, sur les bords du Jourdain,
Ne portait pas de fleurs, mais stérile et honnie,
Elle engendrait l’épine et glanait le dédain.
Lorsque Jésus la vit, venant de Béthanie.
Et pour la transplanter dans son divin jardin
Il voulut la mêler à sa gerbe bénie ;
Mais l’arbre-paria lui déchira la main,
Et son âme s’émut de pitiés infinies.
Et quand de sa blessure une goutte de sang
Tomba, on vit soudain l’arbuste frémissant
Se dresser et s’offrir en merveilleux spectacle,
Ses grands bras épineux tendus vers le ciel bleu ;
Et pour en couronner le front de l’Homme-Dieu
La ronce se couvrit des roses du miracle !
II
Ma vie, en ces temps-là, ne portait pas de roses :
Pauvre arbuste de deuil sous un ciel toujours noir,
Ce n’était qu’un fouillis d’inextricables choses
Etouffant dans son sein les bourgeons de l’espoir.
Mais tu vins à passer dans mes sentiers moroses,
Toi le Maître espéré, l’apôtre du devoir.
Quand le chant se mourait sur mes lèvres mi-closes ;
Et mes yeux fatigués s’ouvrirent pour te voir.
La ronce s’écarta pour te livrer passage,
Tu pleuras quand l’épine effleura ton visage ;
Mon être endolori tressaillit sons tes pleurs.
Et sous cette rosée inconnue et divine.
Mon âme s’entr’ouvrit ainsi qu’une églantine...
Et depuis ce jour-là ma vie est toute en fleurs !
A mes chants
Poème mis en musique par
Hans Jelmoly
De ma douleur vous êtes nés,
Oiseaux chanteurs aux forces frêles;
Quittez mon toit, l'heure a sonné:
Ouvrez, ouvrez vos ailes!
Et si, là-bas, vous rencontrez
Des coeurs émus, des coeurs fidèles,
Chantez pour eux, oiseaux sacrés
Et repliez vos ailes!
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 177 autres membres